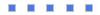

Le lac de Gérardmer. Brume sur la cime n’est pas bon signe !
Et de 20 ! Le festival « Fantastic’Art » international du film fantastique de Gérardmer, qui débarqua en 1994 après avoir quitté les pistes d’Avoriaz, fête mère qui, elle, dura 21 années, fait péter les bougies et le gâteau à coups de hache festive. Pour moi, l’aventure débuta au début des années 2000. Le temps passe et tant passe le temps que certains festivals européens concurrents ont depuis pris une réelle ampleur, comme le Brussels International Film Festival, en Belgique. D’autres sont nés, c’est le cas du PIFFF de Paris ou encore de l’un peu moins récent NIFFF en Suisse, avec un « N » comme Neuchâtel. BIFFF, NIFFF, PIFFF… Gérardmer tient-il la distance face aux trois petits cochons ? Reste-t-il dans la course malgré cette très féroce concurrence ? Que oui mon zombi ! Même Gérard le dit, et j’ai rarement vu Gérard mentir sur Gérardmer.
Ce festival vosgien reste un bien beau « GIFT », mot qui signifie « don » en anglais, acronyme tout trouvé pour se moquer de tous ces titres interchangeables. « Gérardmer International FantasTic’ art », et vous prenez le « T » que vous voulez, on en trouve 3 dans Fantastic’Art ! Point de capitale urbano-urbaine ici, non, mais un petit village dans les Vosges, décor propice à l’évasion…. et à la peur. Le froid, un lac, des bois, des montagnes, quelques autochtones un peu louches… Face à ce paysage Lovecraftien par endroits, voilà hors concours ces repaires de geeks faignants que sont Paris et Bruxelles, des capitales confortables qui ne font que très moyennement rêver le provincial que je suis. Nous reste le véritable « ennemi », Neuchâtel, où il fait si bon vivre en juillet… Peuh ! Dans les Vosges, en janvier, les basses températures poussent les gens à se réchauffer dans les salles entre eux. C’est plus convivial ! Ils parlent volontiers, tous, même les plus coincés, les plus solitaires, autour d’un vin chaud, avec un sujet tout trouvé : les films. L’ennemi commun rapproche les peuples. En l’occurrence non pas Neuchâtel mais le fourbe Wendigo, qui fait son apparition lors de la montée des grands vents froids, poussant des cris perçants et de terribles hurlements ! Mais attention, il n’est pas seul. D’autres monstres rôdent…



… ou complexe d’infériorité par rapport au monumental Morse, Grand Prix 2009 ?
A l’apparente simplicité de The Water et Dark Ring (hum), Nakata charge cette fois son histoire de plusieurs couches, de plusieurs histoires collées qui en font presque, parfois, une sorte d’amas de mini films qui tenteraient de raccrocher les wagons aux succès horrifiques en vogue. Serions-nous là face à la manifestation d’un complexe d’infériorité de l’homme à l’origine d’une date dans le genre – The Ring, qui lui aura définitivement mis la bague au doigt – et qui se rend soudainement compte qu’il n’a rien de neuf à proposer dans ses bagages ? On a ainsi droit à un gros twist, excellemment bien construit, bien amené mais qui a un voire plusieurs trains de retards par rapport à la concurrence. On y trouve aussi comme autre wagon dévoyé un gros emprunt avoué au suédois Morse, grand Prix de Gérardmer en 2009, avec cette même camaraderie contre nature et ces scènes paisibles dans un parc pour enfants. Un peu trop compliqué, ce brassage? « Complex » veut dire cela, compliqué, complexe, en même temps qu’il renvoie au complexe d’immeubles, là où habite notre héroïne, Asuka, étudiante infirmière. Très jolie, évidemment. Elle y loge avec sa famille, de l'autre côté du palier l'on trouve un étrange voisin tandis qu’un petit garçon esseulé traîne dans les parages… A trop vouloir enrichir son histoire, à juxtaposer plusieurs vignettes en forme de passages obligés aisément détectables, Nakata se perd un peu dans les méandres de son complexe de structures narratives qui, tels des immeubles d’une cité surchargent le décor, la narration. Il complexifie tout un ensemble de trames qui, elles, sont archi simples, déjà vues. Et il l'assume, malin, en avouant avoir pondu une sorte de best of de sa carrière pour les 100 ans de la Nikkatsu. Il s'en sort bien mais on voit passer la rame. Alors, raté The Complex ? Aucunement. Nakata prend ses distances d’avec ses œuvres précédentes, manque d’y greffer sa personnalité - ce qu'il ne souhaite aucunement par ailleurs, il garde sa mentalité de soldat en se mettant au service d'un quelque chose - mais ça n’est en rien un échec. On reste dans le cadre de la série B de qualité emballée avec talent.
"Non papa. C'est toi qui va aller la ranger, ma chambre..."
Plusieurs scènes de flippe fonctionnent parfaitement, comme cette lente visite angoissante de l’appartement voisin, lugubre, ou bien encore tout le final, dont une séance d’exorcisme local qui, après le démon juif du Possédée du danois Ole Overdal participe de l’exportation d’un ésotérisme dépaysant. Il est si réussi, cet exorcisme (sur la forme ; je vous laisse juges du résultat sur le démon...), qu’on aurait aimé le voir prolongé, plus montré encore lors du climax à travers cette médium mémorable qui évoque, elle, la réussite à l’espagnole de L’orphelinat via le personnage de Géraldine Chaplin, ou encore celle, britannique, du très bon La maison des ombres à travers la magnifique Rebecca Hall. La scène renvoie aussi aux excès géniaux de la petite série anime Mononoke, un modèle actualisé en terme de mise en image – et de scénario - de ce type de scène. Nakata redevient aussi génie quand il se met à filmer le banal, le quotidien. On ressent quelque chose quand la jeune Asuka se promène dans son quartier, un spleen prégnant, on éprouve davantage encore pendant ses exercices d’infirmière, avec cette crédible tranche de vie bien documentée, brisée par un effroi glacial très intelligemment conduit. On retrouve à cet endroit les secrets de la réussite de L’exorciste de Friedkin, l’approche clinique du documentaire qui précède l’intrusion du romanesque. On appréciera la discrétion des effets sonores, l’absence de style m’as-tu vu souvent déballé ailleurs, l’art de l'ellipse, quelques instants doux bienvenus et un fantôme qui, à moi, m’a donné la chair de poule. L’horrible vieillard renvoie autant à notre propre mort qu’à la tronche cauchemardesque de la mère des soupirs chez Argento, ou encore au final du très bon L’exorciste, la suite, en plus de souligner un fait de société, la solitude dans les grandes villes et cette mort d’un oublié qui peut se produire à l’insu de tous. Ce phénomène n'est pas propre au Japon, il ramène à plusieurs faits divers que nous connaissons, que nous n’oublions pas parce qu’ils nous ramènent à notre propre culpabilité collective ainsi qu’à notre hypothétique fin, pathétique. Nakata fait honneur à sa réputation et frôle là un sujet cher à Kiyoshi Kurosawa tout en se l’accaparant intelligemment. The Complex n’aura pas l’impact des deux bombes précitées à cause de tout un tas de petites choses qui le plombent. J’en ai moi aussi ma claque des enfants démoniaques, le final ouvert est aussi plaisant qu’il peut énerver, passer pour une facilité d’écriture, la redite par rapport à Dark Water, cette poubelle en lieu et place d’un réservoir d’eau, est particulièrement gênante, les acteurs ne sont pas toujours dans le ton. Si la pulpeuse Atsuko Maeda, ex idole du groupe AKB48 s’en sort plutôt bien – sans plus –, de son côté Hiroki Narimiya m’est gentiment sorti par les yeux avec son jeu approximatif et son physique plus proche de celui d’un gigolo gay que d’un crédible brave nettoyeur lambda.
il faut reconnaître que The Complex fut plutôt moyennement aimé des festivaliers. Je me suis d’abord senti un peu seul à l’avoir apprécié, me demandant finalement si j’avais été honnête avec moi-même ou si je m’étais menti pour mieux anticiper l’interview qui allait suivre, que je voulais positive. Puis la rencontre de deux spectateurs, plutôt âgés, qui ont beaucoup aimé le film, m’a conforté dans ma vision des choses. Pas d’effets de style, pas d’exagérations sonores, une approche honnête et respectueuse du genre via un premier degré assumé, des scènes de terreur pure, quand même, et un scénario qui ne livre pas toutes ses clefs, en main ailleurs, cela fait un bien fou. Roublardise ou pas. Il prendra de la bouteille.
Le réalisateur indonésien Joko Anwar. Photo prise lors de notre entretien.
Au cœur d'une forêt inconnue, un homme se réveille après avoir été enterré vivant. Il n'a plus de souvenirs et va découvrir très vite qu'il est, avec les membres de sa famille, la proie d'un tueur sadique et pervers...
Plonger dans l’inconnu, dans un cinéma indonésien que je ne connais encore que très peu, à travers un jeune réalisateur qui, de l’avis de certains, monte en flèche. Joko Anwar. Il surfe sur une bien belle vague, dans le sillon de celle, remarquée, du The Raid de Gareth Evans. Qui fait encore méchamment parler de lui avec son segment de S-VHS, paraît-il démentiel ! Soit dit en passant. Commencer Modus Anomali, c’est d’abord plonger dans une jolie forêt à la fois verdoyante et sombre, tout aussi inquiétante qu’attirante. Si l’on ne sait pas ce qui se cache, là-bas, derrière cet arbre – brrr ! -, on éprouve paradoxalement l’envie de s’y promener, d’aller chercher des trucs, des champignons, la jolie clairière cachée au détour d’un chemin improvisé. L’a priori que j’avais du film ? Négatif, je ne m’en cacherais pas. La bande-annonce ne m’avait pas emballé et le début du métrage, même plaisant ne changea pas la donne. « Encore » un survival dans les bois, « encore » un twist à venir, que l’on devine rocambolesque, « encore » du trash provoc’ avec une femme enceinte crevée à coups de couteaux. Encore, encore, encore, avec en plus un point de détail qui m’a singulièrement gêné : le tout est joué en anglais. Horreur ! Où est le dépaysement, la découverte d’une culture quand un réalisateur veut à se point se vendre à l’international qu’il efface autant que faire se peut ses origines ? « Vivement la version française » me suis-je même avoué, gêné par les nombreux « fuck » entendus ça et là. Passé le constat évident que ce projet sent la carte de visite et la roublardise à plein nez, une sorte de provocation mainstream comme une rébellion affichée ne serait en fin de compte qu’un fond de commerce – rien de nouveau sous le soleil - je me suis surpris à trouver, en grattant ce vernis, une œuvre – mineure - et un auteur. Ces scories difficilement assimilées, on suit avec un plaisir sadique, distancé et non sans humour, les aventures de cet homme qui a perdu la mémoire, ne sait pas qui il est, se rend compte que sa famille s’est faite massacrée et qu’il est pourchassé par un fou dont il ne sait rien. S’il souhaite sortir de ce cauchemar, nous, on ne l’accompagne pas. Le plaisir est bien là mais ludique, uniquement. Des réveils placés un peu partout dans la forêt, des indices qui ne sont là que pour lui nous placent assez vite sur une piste classique : celle du twist à venir, qui va changer la donne. On sait dès lors, habitués que nous sommes à ce nouveau sous-genre qu’est le film à twist, que tout peut arriver. Remember le norvégien Babycall, grand vainqueur à Gérardmer l’an dernier, très sympathique « cliché » du genre « je vais te surprendre ! » mais en fait pas du tout. On ne cherche même plus à deviner le pot au rose : on s’en cogne. On a vu tout et son contraire. Peut-être est-ce un rêve ? Ou l’antichambre de la mort ? Ou alors ce mec là est-il un fantôme ? Ou alors… sans me vanter – je ne fus pas le seul - , je devinai assez tôt une partie de « l’arnaque » mais à la décharge de Joko Anwar, dans le détail elle s’avéra beaucoup plus perverse que ce à quoi j’avais pensé de prime abord. Et de me dire en bout de course que pour inventer une histoire pareille, avec une distanciation pareille et un tel humour noir, il faut être un brin psychopathe dans l’âme. A vouloir toujours surprendre son monde et faire le malin, on en oublie de raconter une histoire qui serait autre chose qu’un délire jetable.

Je ne suis peut-être pas une lumière, encore moins une flèche, mais je suis équipé !
Anwar parvient épisodiquement à faire tenir l’ensemble avec quelques meurtres gratinés et, surtout, lors du basculement, nous gratifie d’un final excellemment bien construit, planant, complètement « autre », qui nous emmène aux côtés d’un bad guy dans sa voiture, longtemps, très longtemps, avant qu’il ne poursuive son office sanglant. La scène fait figure de transition narrative et sensorielle sans user d’une autre transition que la longueur de ce seul et même plan. On traverse le miroir dans le sens du retour sans en voir un seul, de miroir. Le temps de ces quelques instants l’on pense autant à Weerasethakul qu’à Fincher, et les derniers plans du films n’effaceront pas cette impression. Le talent déployé sur la mise en scène, la photo et le son atténuent le manque de budget évident (les scènes de vomi sont craignos, quelques meurtres ont des effets très proches du Z) mais la beauté des plans joue peut-être, aussi, en la défaveur de l’immersion. Car on est loin du craspec en 16mm à la Maniac ou Massacre à la tronçonneuse. C’est beau, la HD. C’est sympa sur la chaîne National Geographic mais sur des films d’horreur, franchement ? Plus généralement, avec l'avènement de la belle image en haute définition me manque de plus en plus cette brume à la Youri Norstein, ici ou ailleurs. J’ai revu The Hobbit il y a peu. J’adore toujours mais cela manque un peu de cette brume, c’est évident. Tout montrer étouffe l’imaginaire. Bref. Reste que Joko Anwar s’en sort très correctement sur ce projet multifonction. Il a un sens du cadre évident, insolent. L’expérience n’est pas désagréable, c’est globalement bien fichu mais j’aimerais davantage de sincérité, d’empathie, de respect pour les personnages, ici tous méprisés. Derrière ce cynisme qui, ne lui en déplaise, côtoie malheureusement le tout venant de la production horrifique actuel, on perçoit parfois un discours plus émouvant, que le sieur n’ose pas – encore ? –exprimer. « Encore », cette fois, parce que je ne connais pas la filmographie de ce réalisateur, largement encensée ailleurs. A suivre, donc. Parce qu’il va de l’avant, le bonhomme ! Comme un Takashi Miike ?…

Jeudi 31 janvier, 23h00. Le film Dagmar - L'âme des vikings se lance dans la salle du Casino. A peine le titre norvégien s’étale-t-il sur l’écran, « Flukt », que le film manque de s’étaler aux yeux de festivaliers déjà hilares. Un titre pareil peut sembler ridicule pour un franco-français. Il pense à « flûte » ou encore à la BD de Hergé « Quick & Flupke » mais pas à un film sanguinaire blindé de vikings. Flukt signifie la « fuite », « l’échappée », me suggère internet. Traduit tel quel pour l’international en anglais, « Escape », mais pas chez nous où, justement, on préfère souligner l’aspect « viking » de l’objet, davantage vendeur. « Dagmar – L’âme des vikings ». Viking ? Beûûarh, ouais ! Toujours est-il que le film se lance sur ce « Flukt alors » périlleux qu’il va être difficile d’effacer des esprits. L’acte est pourtant entériné dans les 5 premières minutes, dès qu’un carreau d’arbalète s’en va effacer un gamin d’à peine 10 ans en même temps que ce piètre malentendu. Bon film.
Ensuite, direction The Bay de Barry Levinson (Rain Man). Un vieux de la vieille qui s’intéresse au found footage, ça m’intéresse. Il veut expérimenter la bête, forcément ! Sur une histoire archi classique de développement d’un virus dans un bled américain, il s’amuse – et nous avec – à présenter rapidement ses personnages puis à instaurer, à l’aide de cet outil, le found footage, un climat de panique lors de la propagation du mal. Caméras embarquées, caméscopes de touristes, caméras de surveillance etc : tout sert, « remonté », à raconter cette histoire non dénuée d’humour. Problème : en plus d’avoir déjà été traité ailleurs, ce canevas, malgré de formidables préliminaires, ne dépasse jamais ce stade. J’eus l’impression que le générique de fin arrivait après la mise en place de l’action mais que point d’action n’émaillait l’objet. Bien tenté, vraiment, mais c’est dommage parce que ce simple exercice de style, brillant, ne m’intéresse pas. Ne me suffit pas. D’autres festivaliers l’ont trouvé vraiment bien par ailleurs, donc…
Cependant, je pense pouvoir affirmer sans trop me tromper cette fois que Mamá, de l’argentin Andrés Muschietti, est le film qui, à ce jour, illustre le mieux l’expression « flipper sa mère ». Grande gagnante incontestée du festival, elle aura salement joué avec les nerfs du public à chacune de ses apparitions. J’ai trouvé cette histoire effrayante, belle, formidablement bien racontée et excellemment bien mise en scène. De prime abord j’y ai vu du calibrage qui tentait de reprendre la formule de L’orphelinat, autre production à succès plus hispanique encore de Guillermo Del Toro, avec cette trame de maison hantée se clôturant par du pure drame. Même producteur, « GDT » tient à faire savoir qu’il les aime, ses freaks. Les personnages archétypaux se relayent – l’héroïne joueuse de métal aux ongles noirs, le psychiatre trop curieux, la vieille tante envahissante, des bonnes sœurs à la Freddy Krueger le tant d’un flashback téléphoné… – et les passages déjà vus se succèdent tout autant – la boîte d’archive jaunie remplie d’affreux secrets, les scènes de couloir, l’accident de voiture… – mais tout ceci est si bien agencé que l’ensemble passe comme un mail via la fibre optique.
Les courts-métrages épatèrent leur monde cette année ; la qualité (bons jeux d’acteurs et bons effets spéciaux) et la diversité furent au rendez-vous. Saluons cette judicieuse sélection faite d’un seul représentant par sous-genre, qui nous évita ainsi la redondance facile et néfaste. Bien joué. L’absurde du lot ? 22 :22, un modèle de prise de tête ludique à l’humour noir assez jubilatoire. Le romantique morbide de service ? Alice et Lucie, borderline sur la forme – comme souvent – mais réussi sur l’ensemble. Notable ! De la belle poésie lente et posée, un brin intello ? L’homme à la cervelle d’or, impeccable, superbe, bien filmé. Le zombi du cahier des charges ? Bien présent avec l’excellent Nightwatch, d’une efficacité redoutable et hilarant (« T’es là, Triton ? Réponds ! »). L’anti-totalitarisme usuel ? Bel et bien dans la place avec le très bien vu Un monde meilleur, un peu longuet sur la fin mais qui s’en tire avec une pirouette si géniale en bout de course qu’elle justifie l’étirement. Le Jeunet-Caresque ? Mort d’une ombre, avec ses effets spéciaux poétiques et cuivrés qui en plus des ombres embarqua le Grand prix cette année. Je finis avec mon chouchou, également celui du public à en croire l’applaudimètre, à savoir le plus inclassable, le plus drôle, le plus bizarre, le plus provocateur… bref, il suffit de dire que la fascinante Claude Perron, découverte avec joie dans les premiers longs d’Albert Dupontel, est de la partie avec des répliques mémorables et que la tonalité du tout rappelle l’humour noir d’un François Ozon en très grande forme pour rendre justice à ce bijou qu’est Zoo.
Je passe rapidement sur la grosse déception que fut la pénible vision du très attendu coréen Doomsday Book signé Kim Jee-won (Deux soeurs, grand prix mérité en 2004) et Yim Pil-sung (le très bon Antarctic Journal). Les 3 courts métrages qui composent ce triptyque sont affreusement mal branlés, mal écrits et… bref, ne nous attardons pas. Ce film a toutefois deux mérites : d’abord celui de mettre en avant l’exceptionnelle qualité des courts métrages plus ou moins francophones proposés cette année au festival, tous sans exception meilleurs que chacune des trois horreurs montrées ici ; ensuite celui de me rappeler que Yim Pil-sung réalisa une adaptation décevante du conte Hansel et Gretel, à 100 lieues de celle, dont on reparlera plus tard avec amusement, du norvégien Tommy Wirkola…
Vendredi 01er février, 20h00. Avant de plonger dans le conte Hansel & Gretel on nous invite d’abord à tâter du con avec 4 minutes en avant-première – et en 3D – du prochain G.I. Joe 2. La scène d’action, impressionnante, nous présente Byun-hun Lee (J'ai rencontré le diable, A Bittersweet Life) affronter de sautillants ninjas en haut d’une montagne. Byun-hun bruyant et efficace. Enchainons ?
Byun-hun Lee dans G.I Joe : Conspiration. Ca va rouler des mécaniques !
Hansel et Gretel - Witch Hunter 3D, c’est un peu le fantasme bourrin de tout rôliste qui se respecte projeté sur grand écran. On a affaire là à un quasi remake décérébré des Frères Grimm de Terry Gilliam, remake non avoué qui en profite au passage pour pousser le bouchon un peu plus loin en réintégrant Peter Stormare en traître chafouin de service. Le réalisateur Tommy Wirkola (Dead Snow), aidé de son producteur Will Ferrel, ailleurs célèbre acteur comique, font passer la pilule via un rythme trépidant, de bonnes idées et une action inventive aussi gore que toonesque, inoffensive et friquée. C’est du bon boulot, galvanisant au possible, comme un tambour battant sans cesse pour vous donner du cœur à l’ouvrage. Ca sonne creux mais le boum-boum est primaire et jouissif.
Pour ma part, la vraie claque du Festival cette année vint du "hors" total, sujet et compétition, avec la Lituanie et ses Vanishing Waves. De ce type de film qui vous touche au plus profond, qui vous secoue, vous remue, que vous aimez tellement que vous avez du mal à vous justifier en l’abordant tant l’envie de le défendre va rendre, vous le savez, votre argumentation maladroite. C’est de la magie que cette œuvre, de la sorcellerie pure. La gifle fait d’abord mal, puis devient caresse dès lors que la peau de cette main de femme fusionne avec votre joue mal rasée. Votre corps s’envahit de picotement, l’extase suit puis la mort se rapproche. La main se fait violence, vous crève l’œil de l’intérieur d’un doigt assassin, puis le cerveau, puis le cœur, pour finir par vous arracher le sexe pour mieux s’en délecter une ultime fois. Vous êtes consentant, baignez dans votre sang mélangé au sperme de vos testicules explosées. Vous êtes mort, heureux.
Vanishing Waves. Je ne vois pas bien là, que font-ils, tous ces gens ? Mais... Oh !
Vanishing Waves… « Des vagues qui s’évaporent ». En voilà un titre joliment poétique. J’ai littéralement plongé dans cette vague, connecté mes synapses à celles de Lukas, suis devenu lui l’espace d’une séance de ciné. Et suis tombé amoureux, tout comme lui, de cette image, de cette fée, de cette sorcière, de cette femme, virtuellement incarnée par la magnifique Jurga Jutaite et interprétée dans notre monde « réel » par… je n’en dirai pas plus, et d’ailleurs ne cherchez pas à le savoir, laissez vous plutôt porter par le courant. Laissez vous bercer par ce violent mélodrame, aidé par la musique démentielle de Peter Von Poehl qui évoquera à beaucoup les célèbres crescendi planants du Michael Nyman de Bienvenue à Gattaca, Prix du Jury à Gérardmer en 1998. Que dire… l’expérience scientifique directement issue du barré Altered States (Au-delà du réel) du frappadingue Ken Russel, la puissance des scènes érotiques, le choc sensoriel de ce repas aussi grotesque que bouleversant qui annonce un twist qui n’en est finalement pas un ; cette orgie sexuelle de maboul qui évoquera à beaucoup celle du Society de Brian Yuzna, les scènes de couples, qui sonnent incroyablement justes… On pleure un peu, on rit peu, on éprouve beaucoup. On partage et comprend tout ce que ressent Lukas, on comprend ses actes, son Inception qui consiste finalement, tout comme dans le film de Christopher Nolan, à chercher dans les nuages un bonheur incompatible avec nos pieds sur terre, tristes à force de se regarder dans le blanc de l’ongle, ternes à trop s’occuper des tracasseries roboratives du quotidien. Et tout ceci est réalisé par une femme, Kristina Buozite, dont c’est seulement le second long-métrage. La tonalité de l’ensemble, résolument féminine, intrigue, et cette ultime morale qui nous explique tendrement que la vie se résume à deux petits cœurs culs nus qui se courent après achève de nous rendre aussi humbles que fiers d’être ramenés à ça. Sacré film, qui remporta pas moins de 4 prix au dernier Fantastic Fest d’Austin, Texas. Meilleur film fantastique, Meilleure réalisatrice, Meilleur scénario, Meilleure actrice. Soulignons également un Prix du Jury obtenu au dernier NIFFF. Gageons qu’il en aurait choppé aussi un à Gérardmer s’il n’y avait été projeté hors compétition.
Il y a un paquet de films que je n’ai pas pu voir cette année. Et peu importe qu’ils soient en compétition ou hors compétition puisque de mon côté je ne fais pas la différence. Dans la mesure du possible, je me suis enquis de ce qu’ils valaient auprès des comparses. Si ces avis sont à prendre avec des pincettes, faites-le quand même avec des moufles parce que ça caille là-bas. Ça caille même grave sa « mère », thématique évidente de cette session 2013. Liste non exhaustive.
Berberian Sound Studio serait un délire arty aussi creux que vain pourrais-je résumer, à en croire ce que j’en ai entendu de la bouche de mes camarades de tranchée. Apparemment, on trouve toutefois quelques jolies scènes dans ce long métrage conceptuel qui a parait-il davantage plu sur un festival dédié à « l’étrange ». Le public n’est ici clairement pas le même.
The Crack : voici là de l’avis d’à peu près… non, de l’avis de toute le monde il s’agit du gros nanar bien gavant du Festival. Ajoutons cette anecdote narrée par plusieurs spectateurs : Christophe Lambert croyant lui-même avoir atteint la fin du calvaire se dirigea vers la sortie alors que les fins à répétitions se multiplièrent encore sur une bonne vingtaine de minutes. L’ultime fin arrivée, un grand « ouf » de soulagement très sonore retentit dans toute la salle. Sévère et cruel le public. C’est de bonne guerre.
La maison au bout de la rue : mince, ça n’est pas le même film que le précédent ? Je croyais que c’était son titre français et, euh… plus sérieusement, à part la présence remarquée de Jennifer Lawrence, l’objet est de l’avis de certains plutôt anecdotique. Au suivant ?
You’re Next : le voilà le favori, au coude à coude avec Mama. Ni la bande-annonce, ni le pitch ne m’avaient emballé, a priori à tort (?) Il faut voir les yeux des spectateurs briller lorsqu’ils parlent de ce film. Je cite : hargneux, violent, rythmé, chargé en rebondissements festifs et bénéficiant d’une actrice particulièrement charmante. Une bête de festival à apprécier dans ce contexte, que je n’ai malheureusement pas pu voir.
Henge : premier film japonais (photo ci-dessous). Petit budget. Il semblerait que tout ceci soit un peu tiré par les cheveux en même temps que l’objet ne dure que 54 petites – longues ? – minutes. Je n'ai malheureusement pas pu le découvrir.
Henge et son doigt d'honneur mutant. "Cloportes, allez vous faire enc... ! "
Citadel : voilà un film qui a paraît-il ses défenseurs sur la toile mais ici que nenni : les avis sont globalement négatifs. Acteur principal peu engageant et longueurs seraient au menu. Je bâche par procuration, en effet.
Cloud Atlas : « chiant comme la pluie ». Comme il pleuvait déjà des sauts de flotte dehors, je préférai choisir une autre salle pour m’abriter.
La charmante Du-na Bae (The Host), argument phare de Cloud Atlas.
Come out and Play : remake mexicain des Révoltés de l’an 2000, qui lui était espagnol. Ca reste hispanique, dans la famille. Nombreuse puisque plein d’enfants veulent du mal à quelques adultes sur une île. « Sympa mais moins bien que l’original » par ici ; « les enfants jouent mal donc on s’en fout » par là… Faites vos jeux !
Forgotten : j’ai complètement forgotten d’aller le voir, celui-là ! Apparemment correct mais certainement pas dans la top liste des festivaliers de cette 20ième édition.
V/H/S : la première projection a déconné, le son était décalé. Bande de ringards, mettez-vous au numérique, la VHS, c’est fini ! Après on s’étonne que ça déconne, Yvonne.
Évènement culte du festival, la nuit fantastique est LE rendez-vous des fous furieux du coin et d’ailleurs, tous venus s’éclater là comme on irait assister à la fin du monde à Bugarach. Sa mère. Il faudrait penser à créer un festival là-bas, soit dit en passant. En guise de pré-générique, les organisateurs avaient prévu une surprise de taille pour marquer les 20 ans : reprendre le générique de fin du Club Dorothée qui, souvenez-vous, citait un maximum d’enfants souhaitant voir leur nom passer à la télé pour leur anniversaire à eux. Pas mal, d’autant que notre ami chauve fétiche se mit à casser un gâteau à la hache – en plastique ? – et qu’une Dorothée zombi envahit soudain l’écran sous l’approbation marquée des festivaliers, pour rappel les plus intransigeants et les plus barbare de tous ! Un véritable asile de fous ! Sous ces bons « hospices » et des étoiles propices, le show put commencer.

Au secours ! Les sushis me mangent ! Sushi grave dans la colle !
Mais non... Ils sont si choux ces sushis.
Le japonais Dead Sushi, (photos ci-dessus) avec toujours Nishimura aux effets spéciaux, donna le « thon » avec ses sushis zombis ( !) qui s’en vont envahir un hôtel et tuer un maximum de personnes. Heureusement, Omelettine, gentille sushiette, est là pour aider notre belle héroïne ! D’une connerie abyssale, le film avait sa place ici. Fauché mais inventif, bête mais généreux, la chose fit pleurer de rire la moitié de la salle tandis que l’autre, consternée, attendait la suite. J’en pleure encore. De rire.
On enchaîna avec le hollandais New Kids Nitro. Nitro bon, nitro mauvais mais encore une fois, pour voir un film pareil le contexte s’avéra parfait. Comme le disait Coluche : « Pire, c’est grave, hein ! Eh bah là, c’est encore pire ». A faire rougir de honte Uwe Boll et les frères Farrelly réunis, cet objet filmique franchit horde tabous avec entrain et enchaîne gag sur gag à une allure qui force le respect. Les abysses, finalement, ne sont pas une limite vers le bas et le fond s’avère encore un peu plus loin. Si, c’est possible ! Le trou noir, certes, mais alors mes zygomatiques ne sont pas prêtes d’oublier ça. A voir en optimisant le contexte : à plein. Bières et chips de rigueur. Crevé, je suis ensuite parti, laissant le public découvrir le finlandais Iron Sky.
On ne le voit pas bien mais derrière le banc et le banc de canard, sous l'eau il y a un banc de poissons.
D’édition en édition, la rumeur voudrait que le festival de Gérardmer soit menacé d’arrêter faute de sous. Au banc des accusés (photo) : les organismes de subventions locales et régionales, à la peine à en croire cette interview de Lionel Chouchan, son fondateur. Sachez qu’afin de contrer cette malédiction, en guise de contre-sort une 21ème édition a déjà été annoncée pour 2014 lors de la cérémonie de clôture. Tout va bien. Ou alors ils bluffent, Martoni. Gérardmer, Cité de la peur ? Si j’en entends plusieurs dénigrer le festival et sa programmation, en particulier les films en compétition, a priori pas toujours au niveau, ça n’est toujours pas mon avis cette année. La diversité était bien là, la prise de risque aussi. Chacun y trouva son bonheur, péloches hors-compétition incluses. Et conjointement à la nuit fantastique, l’autre événement über vivant de ce festival, la projection des courts-métrages, garantit toujours autant sa réussite globale. Un reproche, un vrai, afin que l’on ne m’accuse pas d’être un fieffé corrompu ? Oui. Juste une remarque. Il est un sujet sensible à mes yeux très sensibles, justement : l’utilisation de la 3D et celle du found footage pendant un festival. Assister à un évènement de ce type, c’est enchaîner film sur film, en voir beaucoup, trop, et baigner dans plusieurs ambiances, plusieurs univers, plusieurs âmes, riches, le temps des festivités. Cela demande beaucoup, et à mes rétines, et à ma cafetière. Alors voilà, la 3D rigolote d’Hansel & Gretel m’a affreusement épuisé, et les images vidéo « found footage » de The Bay m’ont littéralement agressé les yeux. Après ça, j’avoue avoir éprouvé davantage l’envie de profiter du décor, du vrai paysage vosgien, voire même de mes paupières fermées, plutôt que de vouloir m’enquiller une séance de plus. Peut-être suis-je « un peu trop vieux pour ces conneries » mais n’en suis pas certain, vraiment. Pouf, pouf.
Sur ses pourtours, annexes et friandises, le festival en lui-même était encore une fois bon enfant, paisible, généreux et blindé de gens d’une gentillesse notable. La simplicité des bénévoles – y compris la mienne donc – fait toujours autant chaud au cœur, celle de stars toujours respectueuses du public également. La neige s’invita un peu tardivement mais elle vint quand même. Tant mieux puisqu’elle fait partie intégrante du décor depuis belle lurette.
Bilan asiatique ? L'Asie émailla le festival de sa présence toujours bienvenue, éparse et positive. Mais elle ne s'imposa pas comme elle le fit par le passé, dominée qu'elle fut, dans ce cadre, par le très efficaces Mama et autres talents, qu'ils soient nordiques ou baltes...
GRAND PRIX – GRAND PRIZE
Soutenu par/Supported by la Région Lorraine
MAMÁ de/by Andrés MUSCHIETTI (Espagne&Canada/Spain&Canada)
PRIX DU JURY – JURY PRIZE EX-AEQUO
BERBERIAN SOUND STUDIO de/by Peter STRICKLAND (Royaume-Uni/UK)
& THE END (Fin) de/by Jorge TORREGROSSA (Espagne/Spain)
PRIX DU PUBLIC – AUDIENCE AWARD
soutenu/Supported by La ville de Gérardmer
MAMÁ de/by Andrés MUSCHIETTI (Espagne&Canada/Spain&Canada)
PRIX DE LA CRITIQUE – CRITICS’ PRIZE
BERBERIAN SOUND STUDIO de/by Peter STRICKLAND (Royaume-Uni/UK)
Décerné par le Jury de la Critique composé de six journalistes/Awarded by a jury of six journalists
PRIX DU JURY JEUNES DE LA REGION LORRAINE – RÉGION LORRAINE STUDENT PRIZE
MAMÁ de/by Andrés MUSCHIETTI (Espagne&Canada/Spain&Canada)
Décerné par le Jury jeunes, composé de lycéens de la Région Lorraine
Awarded by twelve high school students selected by the Région Lorraine
PRIX DU JURY SYFY – SYFY JURY PRIZE
YOU’RE NEXT de/by Adam WINGARD (Etats-Unis/USA)
Syfy a rassemblé 5 inconditionnels du genre fantastique via un jeu concours pour composer le Jury Syfy
Syfy has brought together 5 fans of the fantasy genre through a contest to select the Syfy Jury
Le Jury Courts-métrages de la 20e édition du Festival International du Film Fantastique de Gérardmer, présidé par Vincent Perez et composé de Fouad Benhammou, Guillaume Lubrano, Pierre Perrier, Fanny Valette et Jemima West a décerné son prix à:
GRAND PRIX DU COURT-MÉTRAGE – BEST SHORT FILM GRAND PRIZE
MORT D’UNE OMBRE (Death of a Shadow/Dood van een shaduw) de/by Tom VAN AVERMAET
(Belgique&France/France&Belgium)
Et un grand bravo aux bénévoles, avec une spéciale dédicace aux vendeurs et vendeuses de vin chaud qui se trouvaient près de l’Espace Lac, tous joyeux membres d’une association pour le Don du sang de circonstance… encore que les vampires, hormis The Thompsons, manquaient à l’appel cette année.
Voir aussi : mon entretien avec le réalisateur Hideo Nakata
Voir aussi : mon entretien avec le réalisateur Joko Anwar
Lien vers mon CR de l'édition 2009
Lien vers le CR d'El Topo sur l'édition 2004
