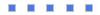Un mélodrame valant beaucoup mieux que sa réputation d'Ozu mineur 
Crépuscule à Tokyo est un Ozu mal aimé, mal accueilli en son temps par la critique qui y voyait un ratage, un film manquant de la "subtilité" habituelle chez le cinéaste. Au point que l'excellent livre d'Hasumi Shiguéhiko disponible dans la collection Cahiers du Cinéma se retrouve à l'évoquer de façon suffisamment longue et détaillée afin de réhabiliter sa place dans l'oeuvre ozuienne. Et le visionnage de ce mélodrame poignant et noirissime donne envie de se faire le fervent avocat de cette cause-là. Ce qui m'amène à rappeler qu'il y a deux visions cinéphiles dans l'appréciation de ce genre si décrié: l'école Sur la Route de Madison qui aime que le mélodrame soit adulte, retenu, suggestif et mettant à l'index toute vélléité allant dans le sens opposé comme une "facilité", alors que l'emphase ou la retenue (de meme que le fait de montrer ou de suggérer) sont deux directions cinématographiques pouvant donner leur lot de chefs d'oeuvre ou de navets suivant leur dosage ou la manière dont on les utilise (rayon emphase les films de Douglas Sirk sont des sommets du cinéma mondial tandis que Dancer in the Dark est un sombre navet). Etant plus proche de cette seconde vision que de la seconde que je trouve très dogmatique et cinéphiliquement correcte (vision qui peut amener à encenser des films catenaccio qui évitent les pièges de leur sujet plutot que de le transcender), j'ai encore plus envie de défendre cet Ozu-là. Parce que oui c'est un film peu suggestif mais à une échelle ozuienne, on est quand meme loin de l'exacerbation ultravisible des sentiments chez Woo, Sirk ou Almodovar et de l'emphase assumée présente chez ces (grands) cinéastes, c'est un espèce d'entre deux qui n'est pas compromis mou du genou mais bonne distance de regard de cinéaste sur son sujet.
Ozu fait d'ailleurs de la répétition une brillante arme frappant en plein coeur : la répétition du motif du froid (les personnages parlent plusieurs fois dans le film de cette sensation-là et la neige y vient changer le cours d'une conversation), répétition de plans de personnages différents quittant les memes lieux, répétitions des parties de mahjong, répétition de ces moments où les personnages sont assis silencieux à mesurer l'étendue de leur désespoir. Ces répétitions sont porteuses d'une insistance accroissant la dimension dramatique du film ou enfonçant le clou du ton noirissime du film. Audace d'Ozu par rapport au genre néanmoins: le film commence là où la plupart de ses autres se finissent mais aussi là où la plupart des mélodrames se finissent, lorsque la question du mariage consenti ou pas est réglée. Un postmélodrame? Oui mais aussi la continuation de l'Amour d'une Mère, Ozu de la période muette à la fin plus optimiste malheureusement perdue mais qui savait déjà prendre le spectateur quasi-physiquement, un pendant parlant où ne subsisterait que la noirceur d'avant sa fin et où la question du père absent et de ce que son absence a pu laisser comme questions en suspens vis à vis des enfants a été remplacée dans la narration par celle de la mère absente. Un mélodrame qui a son lot de scènes déchirantes sauf qu'Ozu ne les met pas en conclusion mais juste avant la conclusion ozuienne attendue: SPOILERS la scène du lit de mort avec le si décrié discours de la malade (qui n'est que désir de vitalité exhibé au grand jour dans une oeuvre d'une grande noirceur) qui justifie à elle seule les choix ozuiens (sa retenue habituelle aurait donné un film évitant les pièges de la scène sans la transcender émotionnellement, un pathos excessif aurait encouru le risque de l'apitoiement, le score du film est d'ailleurs à cette image), l'ellipse qui s'en suit à l'efficacité lacrymale n'ayant rien à envier au meilleur de Kitano versant mélo, l'annonce de la mort faite à la mère, celle du "bouquet de fleur", l'attente dans le train. FIN SPOILERS
Pour le reste, c'est le dernier Ozu avant le passage à la couleur, il est impeccablement découpé rythmiquement (sans les quelques plans un peu trop longs qu'on trouve souvent chez le cinéaste) et on y trouve déjà le naturel dans l'exécution du "système Ozu" (troupe d'acteurs, manière d'évoquer la culture de son pays au travers d'un type de cadrage, de montage et de distance à l'objectif) des Ozu en couleur. Et finalement il vieillit bien mieux que d'autres Ozu favoris des référendums critiques et cinéphiles. Un chef d'oeuvre du mélodrame et un chef d'oeuvre tout court.
Un grand film dramatique.
Dans sa perspective de toujours renouer avec le mélodrame définitif, véritable chronique d'âmes en perte de repères dans un espace où tout leur fait face, Ozu signe un chef d'oeuvre du cinéma dramatique et donne en même temps à Arima Ineko (Akiko) et Hara Setsuko (Takako) deux rôles extraordinaires. La première, à la beauté divine, bouleverse par son charisme et sa personnalité taillée dans le diamant surtout que son personnage est loin de faire dans la simplicité. Elle se cherche, questionne son entourage, culpabilise jusqu'à remettre en cause ses propres racines (sacrilège dans la philosophie nippone), malgré l'aide et la bonne volonté de sa soeur, Takako, interprétée une nouvelle fois sublimement, accuse le poids des difficultés sur ses épaules et se débrouille tant bien que mal pour ne pas mettre à mal l'ambiance familiale et casser les liens déjà bien fragiles. Il faut voir en effet Ryu Chishu dans la peau d'un père -comme d'habitude- très sec et autoritaire encaisser sans broncher la douleur commune de ses deux filles.
Crépuscule à Tokyo est aussi le dernier film en noir et blanc de son auteur, poussant depuis
Printemps tardif son style à son summum (qui trouvera néanmoins un traitement et un rigueur définitive dans
Dernier Caprice, son avant-dernier film) et c'est pourquoi il distille toutes les saveurs du cinéma riche d'Ozu, aussi bien fondamental que formel. Car toute la douleur qu'éprouve chaque personnage, tout le poids des difficultés, se ressent au travers d'une mise en scène basse, stricte, cumulant les plans vides sans signification, juste là pour "combler" tout moment de silence comme il se doit, ou bien pour oublier le temps de quelques secondes (une montagne, un hall d'entrée, un jardin) la mélancolie de ses protagonistes, de ces deux soeurs -fabuleuses-, éreintées par ce qu'elles vivent à cause des retrouvailles plus que tumultueuses avec leur mère, disparue depuis des années après le retour de leur père des suites de la guerre. Mais ce long-métrage peut-être perçu aussi comme une longue discussion de la vie de tous les jours, autour d'un carafon de saké et d'un jeu de mah-jong.
Crépuscule à Tokyo demeure aussi un Ozu difficile et pessimiste, inoubliable grâce aux deux actrices qui mènent le bal, et il est aussi important de noter que, une fois n'est pas coutume, une personne réussit à faire un poil d'ombre à l'une des plus grandes du cinéma japonais classique (Takamine Hideko à part) et cette personne n'est autre que Arima Ineko, qui n'a pas eu la carrière qu'elle méritait et c'est bien triste.
Mal de mère
Sans doute l'oeuvre sommet du grand réalisateur, qui réussit en un habile film de caser tous les thèmes, qu'il aurait tenté d'exploiter à chaque nouvelle oeuvre.
Tout y est magistral: des cadrages aux personnages à l'histoire pleine de rebondissements, tout en restant hyper réaliste.
Impossible de résister aux malheurs des unes et des autres; seule la toute fin s'étire un peu trop longuement en longueur pour tenter d'arracher encore quelques larmes...
Un chef-d'oeuvre indéniable!
grand film ozuïen atypique (et mésestimé) 
[pour essayer de dire l'importance de ce film que l'on considère parfois contre-nature de la part d'Ozu, je suis amené à dire ce qui s'y passe, en particulier dans le second paragraphe]
De 'Crépuscule à Tôkyô', le dernier film en noir et blanc de Yasujiro OZU, ou pourrait dire qu'il est atypique et purement ozuïen à la fois. Atypique car il s'agit manifestement de son film le plus tragique, douloureux, mélodramatique. Mais purement ozuïen car le cinéaste y conserve le même principe de mise en scène : art de la suggestion, de l'ellipse, plans fixes à hauteur du quotidien ("à hauteur de tatami"), qui constitue par delà ses histoires et ses thèmes privilégiés (centrés sur la famille, ses règles et ses dérèglements), la raison de vivre et de filmer de Ozu, comme le comble de son génie inimitable ; ce quotidien qui forme le ciment de ses plans et de ses films, en ce qu'il encadre les personnages en leur assignant une place, toujours la même, que ce soit dans le foyer familial, dans un bar, ou autour d'une table où l'on joue au mahjong (on pourrait n'y voir qu'une critique de la société japonaise, mais ceci témoigne aussi chez Ozu d'un amour de la simplicité) ; ce quotidien que Ozu saisit et transmet dans son essence même, dans son amertume et sa saveur mêlées.
Le film commence comme la suite envisageable de bon nombre de films d'Ozu de cette période s'étendant de la fin des années 40 ('Printemps tardif', 1949) au début des années 60 ('Le Goût du Saké, son dernier film, 1962), où la fille accepte finalement à contre-coeur un mariage arrangé : le père (l'incontournable Chishu RYU), en rentrant du bar après sa journée de travail (situation typiquement ozuïenne), a la surprise de trouver à son domicile sa fille aînée (Takako, interprétée par la toujours sublime Setsuko HARA) ; elle lui explique qu'elle a quitté son mari en amenant avec elle sa petite fille, constatant l'échec du mariage arrangé par son père. On pense que le film va de nouveau traiter principalemnt du problème de cette tradition japonaise, mais il s'agit d'une fausse piste. La soeur cadette (Akiko, interprétée par Ineko ANIMA), entre dans le cadre, elle ne fait que passer, et à peine née à la conscience du spectateur, disparait à l'autre bout. Pourtant, c'est autour d'elle que va se nouer le drame, dans un Tôkyô hivernal, et l'on se souviendra que cette disparition prématurée du cadre était prémonitoire. Akiko est à la recherche de son fuyard de petit ami, qui se détourne d'elle au moment où elle a un secret à lui dévoiler. Parallèlement, elle est amenée à rencontrer sa mère (revenue s'installer à Tôkyô avec son nouveau mari) qui l'a abandonnée, à l'âge de 3 ans, et que par conséquent elle n'a jamais connue, d'où un vide affectif considérable (la mère est souvent absente de la famille ozuïenne). Double trouble (auquel s'ajoute ses doutes sur l'identité de son vrai père), dont les composantes se superposent lorsque Akiko est contrainte d'avorter (pour sauver la face aux yeux de la société en général, et de son père en particulier, qui ne se doute pas de sa situation) : elle abandonne l'enfant qu'elle devait avoir. Trouble qui se concluera de manière tragique, par la mort d'Akiko.
C'est donc le film le plus douloureux et grave de Ozu (outre la mort d'un personnage, l'amertume y tend plus qu'à l'accoutumée à la rage, on y quitte violemment le foyer familial après avoir déclaré à son père "je te hais", autant de situations inhabituelles chez Ozu), mais alors en tant que mélodrame, il est plutôt atypique... car profondément ozuïen. La tragédie en effet ne provoque aucun accident du récit ni de la mise en scène : ils inscrivent sans artifice la dérive d'Akiko dans le quotidien le plus normal et ozuïen qui soit. Akiko, à la recherche de son petit ami, rend visite aux camarades de ce dernier ; la scène est encadrée par le même plan large englobant la gare près de laquelle résident les amis ; lorsqu'Akiko arrive, les gens attendent le train qui les ramènera chez eux après leur journée de travail ; pendant qu'Akiko quitte les lieux (sans avoir obtenu l'information qu'elle recherchait, à savoir où se trouve son petit ami), le train arrive en gare et les gens y montent : le drame est d'autant plus cruel qu'il se joue dans le cours normal de la vie, dans la respiration du quotidien. Un autre exemple de cette cruauté et que les proches d'Akiko sont constamment en décalage par rapport à ses sentiments (sans parler de son père et de sa soeur qui ne savent pas qu'elle est enceinte) : par exemple, ils pensent que ce qui apparait comme de la morosité chez Akiko est due à l'absence de son petit ami, losqu'elle vient de sa rencontre douloureuse avec sa mère.
La mise en scène de la mort d'Akiko est, quoiqu'on en dise, également une réussite exemplaire de l'art d'Ozu, dans un contexte fortement mélodramatique : le klaxonnement d'un train (qui ramène les gens chez eux après leur journée de travail) entendu depuis le restaurant que vient de quitter Akiko (en même temps qu'elle quitte son petit ami entré peu de temps avant dans le restaurant) ; puis le père et la soeur aînée d'Akiko réunies avec le tenancier du restaurant (l'inoubliable Kamatari FUJIWARA, qui illumine de ses airs bonhomme chacun des films auxquels il participe, des Mikio NARUSE des années 30-40 aux films d'Akira KUROSAWA), qui a accompagné la jeune femme, autour du lit d'hôpital de cette dernière ; puis le tenancier du restaurant qui, pendant que le temps d'Akiko est compté, prend le sien pour quitter l'hôpital ; puis Takako descendant d'un taxi, vêtue de l'habit de deuil. On a pu reprocher à Ozu d'user dans ces scènes d'ellipses moins subtiles que dans ses autres chef-d'oeuvres, mais le reproche est injuste car d'une part, il s'en sort admirablement dans un contexte mélodramatique de crise profonde, mais surtout, on commet selon moi l'erreur qui consiste à penser que l'ellipse chez Ozu n'est qu'affaire de pudeur, alors qu'elle revêt un caractère philosophique, qu'elle sert un art de vivre, littéralement. Ainsi, la scène où le tenancier du restaurant prend son temps pour quitter l'hôpital ne sert pas à instaurer un suspense facile et de mauvais goût (Akiko va-t-elle mourir? Est-elle en train de vivre ses dernières secondes?), mais encore une fois à inscrire le dénouement de la vie dans l'écoulement régulier de cette dernière (la présence de l'horloge dans le plan peut être mal interprétée). Le choix de ne pas filmer frontalement le moment où Akiko est renversée par le train (ou tout du moins le passage du train, ou encore sa conséquence directe sur le lieu du drame), mais de rester à l'intérieur du restaurant en compagnie du tenancier et de l'ami d'Akiko, n'est pas un cliché en matière d'ellipse, c'est dire qu'au fond l'enjeu n'est pas de savoir s'il s'agit d'un suicide ou d'un accident : l'enjeu, l'important chez Ozu, n'est pas la mort (c'est selon moi pour cette raison qu'il ne la filme pas, et non pour des raisons de pudeur ou de facilité) mais son attachement à la vie. En revanche, il choisit justement de filmer frontalement, chose inhabituelle, cette scène mélodramatique et poignante où Akiko, en larmes sur son lit d'hôpital (encore que cela reste... très pudique), se tourne vers son père et sa soeur et prononce les mots : "je veux vivre". Les films de Ozu sont comme Akiko, ils disent leur attachement à la vie, ils veulent s'enivrer encore de la ritournelle du quotidien (de celles que l'on entend abondamment en fond musical dans ce film comme dans tous les autres), y compris son film le plus douloureux, ce 'Crépuscule à Tôkyô' qui conclut à l'éclatement de la famille : chacun(e) repart de son côté, la mère quitte Tôkyô, Takako regagne son foyer et son mari (pour épargner à sa fille le destin d'Akiko), et le père se retrouve seul comme souvent à la fin des films d'Ozu.
Grand film profondément ozuïen avant d'être atypique, loin d'être contre-nature, 'Crépuscule à Tôkyô' témoignait, dans la douleur et la gravité certes, et ce bien avant 'Dernier Caprice' (que l'on apprécie pour sa légéreté face à la mort, mais qui était pour le coup plus explicite à ce sujet), de l'indéfectible attachement à la vie - simple - d'Ozu (je préfère parler d'attachement à la vie plutôt que de résoudre la question manichéenne et quelque peu superficielle : "Ozu, cinéaste optimiste ou pessimiste?").
On ne choisit pas sa famille
Il s'agit là d'un des films les plus pessimistes d'Ozu, qui brasse des thèmes aussi peu allègres que le suicide, l'avortement, les enfants abandonnés et les épouses délaissées. Le style délicat et feutré du cinéaste fait encore une fois merveille, et si la narration peut sembler un brin austère, on ne peut que s'incliner devant l'intelligence du traitement, la qualité de l'interprétation et le soin apporté à la photo, avec ces cadres très travaillés et ce noir/blanc riche en nuances de gris qui témoignent d'une volonté d'épure de plus en plus décisive de la part d'Ozu. Quant à la musique, délicieuse, elle ne dépareillerait pas dans un Carné ou un Renoir des années 30.
Chef d'oeuvre méconnu 
Dernier film en noir et blanc d'Ozu avant ses 6 films couleurs, "Crepuscule à Tokyo" est un film peu projeté. Pourtant sans le moindre pédantisme cinéphilique, on peut affirmer que c'est un chef d'oeuvre absolu. Un film magnifique très émouvant, un Ozu atypique car nettement plus sombre que les autres. En effet, alors que les films d'Ozu sont généralement empreint d'une mélancolie douce, la mort d'un personnage principal rend ce film beaucoup plus tragique.
Bref, tout à fait d'accord avec la remarquable critique ci-dessus et je mets 5 en prime car ce film mérite d'être connu...
un immense mélodrame d'ozu 
Tout a été dit sur ce splendide mélodrame qui dénote à bien des égards dans la filmographie d'ozu - la mort d'un personnage, des scènes de ménage franches et sans retenue, l'absence des fringuants quinquagénaires qui entourent habituellement les héros... - mais s'avère plastiquement éblouissant (on y trouve les plus beaux plans de transition entre deux scènes -plan d'usine, allée parsemée de cafés- de sa filmographie et quelques belles et fortes audaces -ellipses magistrales, place de la caméra derrière la tête de la mourante lors de l'agonie d'aikiko, un peu comme dans Barberousse de Kurosawa d'alleurs). Un peu comme si Ozu avait jeté sur la pellicule ses dernières colères et s'était délesté de sa cruauté avant d'attaquer le cycle sereinement contemplatif des films en couleur de 1958-1962.