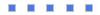

| Elise | 1  |
Même Odagiri Joe lutte pour rester éveillé |
| Xavier Chanoine | 1.5 | Une expérimentation à côté de la plaque |

Il est parfois difficile de se relever d’une chute lorsque les auteurs qui nous ont fait rêver, et dans un certain sens fait découvrir que le cinéma asiatique avait un « truc » de différent par rapport à ce que l’on voit régulièrement à la télévision ou dans les salles de banlieue, ne sont plus ce qu’ils étaient. Ou ne sont plus du tout. Un peu comme dans l'introduction de La Fleur de mon secret d'Almodovar où Manuela harcèle les médecins pour savoir si oui ou non son fils est mort, car elle n'y croit pas. On est ici dans la même situation,on ne veut pas y croire. Kim Ki-Duk fait officiellement parti de cette catégorie de cinéastes qui ont sans doute atteint leur maturité trop tôt ou trop rapidement et qui ne font que se recycler et se répéter au fil des années depuis un petit moment déjà, film après film malgré quelques menus rayons d’espoir hélas maintenant sous forme de mirages. Trop rares, les élans gracieux du cinéma de Kim Ki-Duk ne sont plus depuis Time, comme si le temps s’était justement arrêté. Manqués sont les paris audacieux entamés avec Souffle, qui même s’il ne manque pas d’air, mais de souffle, n’arrivait pas à franchir la ligne d’arrivée dans de bonnes conditions, ou comment marquer au fer rouge cette propension à montrer coûte que coûte que l’on est un auteur à part dans le cinéma coréen. Avec Dream, on ne rêve plus. Mise à mort. Automutilation d’un auteur qui s’acharne à faire de la poésie sous cellophane alors qu’il n’en a plus les moyens depuis L'Arc, son dernier chef d’œuvre bataillant face à l’adversité critique. Avec Dream on a la sensation d’être emporté dans un vent de folie qui n’intéresse et qui ne fait rire que Kim Ki-Duk, seul détenteur des clés d’un raisonnement qui nous échappe, trop tiré par les cheveux pour paraître un minimum droit. On pensait être sur une autoroute à quatre voies avec les chemins balisés depuis belle lurette (The Birdcage Inn il y a dix ans maintenant), et l’on se retrouve sur une route de campagne peu éclairée annonçant irrémédiablement l’accident tôt ou tard. Et au film de commencer par un accident de voiture qui annonce l’interconnexion entre Jin (Odagiri Joe) et Ran (Lee Na-Young) sans que le spectateur ne le sache, le cinéaste préférant jouer du mystère des situations et de l’absence frénétique de logique qui font de Dream ce qu’il est, à savoir une drôle de parabole sur l’amour et le rêve rassemblant deux êtres étrangers qui vivent chacun dans la douleur à cause de leurs ex.


Kim Ki-Duk s’enlise alors dans un discours sans queue ni tête, jouant sur les ellipses et la notion du désire pour véhiculer son propre message : partir de simples histoires d’amour pour aboutir à un méli-mélo temporel où l’on perd la notion de temps et d’espace, d’imaginaire et de réel, dans un pur soucis stylistique qui nous ferait confondre rêve et réalité. Ici le cinéaste pousse l’expérimentation jusqu’à modifier le rêve dans le rêve, jusqu’à déstabiliser ses personnages par une souffrance et une folie exacerbées qui vont crescendo, les tentatives de Jin de rester éveillé sont ainsi un bon exemple et renvoient au cinéma cruel et douloureux de Kim Ki-Duk depuis L'Île. Mais une fois de plus on ne sait pas bien où il veut en venir, ce qui relevait jusque là de l’expérimentation va jusqu’à se transformer en ennui monstre passé le premier quart d’heure d’agréable découverte. L’expérience vire littéralement au cauchemar parce que le cinéaste fait montre d’une froideur inhabituelle dans un domaine qu’il maîtrise pourtant, où les sentiments et la réflexion des personnages les obligent à communiquer beaucoup plus qu’avant, beaucoup plus qu’avant Time disons. Mais les tentatives de réflexion et les idées farfelues (Ran grimaçant, Jin se greffant du scotch sur les yeux pour ne pas dormir, le coup des menottes) n’aboutissent qu’à un résultat grotesque à peine réévalué à la hausse par une séquence onirique dans les hautes herbes où l’interconnexion entre Jin et Ran donne lieu à une véritable confrontation avec leurs ex, dont les rôles sont tour à tour changés à chaque nouvelle réplique créant un nouveau mystère sur ce qui est vrai et sur ce qui ne l’est pas. Ou comment créer la confusion en jouant avec le rêve, telle est sans doute l’une des rares idées bien exploitées dans Dream qui pêche plus par suffisance et sureté (le nom de Kim Ki-Duk suffit déjà à excuser bien des points chez les cinéphiles) que par ses thématiques abordées certes déjà vues ailleurs mais correctement recyclées ici : l’exploration de l’être, l’exploration de l’amour par une certaine forme de souffrance.


Non, le plus risible ici réside dans les séquences où les deux tourtereaux se doivent de rester à tout prix éveillés pour éviter le carnage, toutes plus ennuyeuses les unes que les autres. On fait donc un peu de broderie sur un tissu d’un rouge intense à peine ostentatoire, on grave des caractères sur de la pierre (sans doute est-ce là le métier d’artiste de Jin) pour passer le temps ou pour comprendre ces pénibles rêves, on fait la grimace (d’accord c’est un procédé, mais il est ici juste hors propos avec le ton général), on se plante des aiguilles dans le crâne (au lieu d’avaler un kiwi ou de boire un café serré), on s’attache avec une menotte ou comment flanquer au visage du spectateur la métaphore de deux êtres qui commencent à s’aimer, se protéger et qui se lient par le rêve. Au secours. On commençait déjà à voir des bribes de vraie lourdeur avec Time, ici la suggestion (censée pourtant être motrice du mystère) n’est définitivement plus. On le ressent aussi par une photographie inégale où le gros travail sur la lumière est contredis par des choix artistiques parfois douteux, où les rêves annoncés par un flou artistique et matérialisés par un filmage saccadé du pire effet contrastent avec une mise en scène tout à fait banale lors des passages dialogués. Ou bien cadrant de trop près ses acteurs jusqu’à l’étouffement. L’utilisation foutraque du score annihile toute tentative de rendre crédible un univers qui ne l’est pas, qui plus est lorsque les mélodies ne s’accordent pas avec ce qui se déroule à l’écran, excepté ce thème au piano en guise d’échos d’outre-tombe. On y retrouvera aussi à redire au rayon du montage, de l’inspiration pas toujours là des comédiens où l’on pourrait presque surprendre Odagiri Joe se retenir d’esquisser un vieux sourire lors des séquences censées être graves et perturbantes. Il doit encore se demander où il est venu se fourrer en causant japonais à des coréens et en comprenant parfaitement ce qu’il se dit ; mais le critique avisé mettra cela sur le compte de l’imaginaire, du monde dans lequel Kim Ki-Duk nous convie, un monde où la langue n’est pas une barrière et où l’on peut maîtriser le rêve et interagir avec sans contraintes si ce n’est de perdre la vie : chacun l’apprendra à ses dépends au travers d’un épilogue poétique à peine attendu, où les retrouvailles avec l’amour et la tranquillité sont symbolisées par la métaphore de la naissance d’un papillon. Voilà donc l’un des premiers films de Kim Ki-Duk où l’on ne ressent absolument rien devant de telles images. A ce tarif, c’est grave.