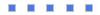


La première fois, j’ai vu ce film dans un état limite (fin de semaine de l’harassant Festival de Cannes, entre midi et deux). J’avoue, j’ai somnolé, mais peut être parce que Ivre de femmes et de peinture (quel titre con, vous imaginez un « Drogué de femmes et de cinéma »?) manque d’ivresse, ou de femmes, même s'il y en a cinq, pas de peinture ça c’est sûr, mais ce n’est pas un thème palpitant à filmer. J’avais surtout l’impression d’avoir vu mieux comme portrait d’artiste, que les idées du film (la difficulté de se plier à une commande ou de pénétrer l’élite quand on est roturier) frisent le cliché. Chihwaeson a bénéficié de moyens somptueux, est parfaitement cadré, très joliment décoré, mais je cherchais la chair.
 Finalement à la deuxième vision (en forme ce coup-ci !), c’est une autre impression qui se dégage : Chiwaseon est un film bien étrange. Il contient au total un nombre de plans très important, ce qui est déjà étonnant pour un film qui n’est pas dut tout « d’action » et encore plus pour un film asiatique. Le film est fait de courts moments et ose des transitions violentes : un gros plan suivi de plan de paysage, une scène intimiste suivie d’un rappel historique avec figurants, ou une scène de peinture enchaîné avec de la baise. Parlons-en, d’ailleurs, outre le fait que les coréennes du film et leurs robes, toutes de rouge et blanc, sont un vrai bonheur : ces scènes crus sont parmi les meilleures du film, notamment celle qui est interrompue brutalement au milieu par l’incendie de la maison. Le vieux réalisateur a sûrement dû se délecter à faire ainsi son Imamura, à loger quelques petites métaphores grivoises dans les dialogues.
Finalement à la deuxième vision (en forme ce coup-ci !), c’est une autre impression qui se dégage : Chiwaseon est un film bien étrange. Il contient au total un nombre de plans très important, ce qui est déjà étonnant pour un film qui n’est pas dut tout « d’action » et encore plus pour un film asiatique. Le film est fait de courts moments et ose des transitions violentes : un gros plan suivi de plan de paysage, une scène intimiste suivie d’un rappel historique avec figurants, ou une scène de peinture enchaîné avec de la baise. Parlons-en, d’ailleurs, outre le fait que les coréennes du film et leurs robes, toutes de rouge et blanc, sont un vrai bonheur : ces scènes crus sont parmi les meilleures du film, notamment celle qui est interrompue brutalement au milieu par l’incendie de la maison. Le vieux réalisateur a sûrement dû se délecter à faire ainsi son Imamura, à loger quelques petites métaphores grivoises dans les dialogues.
Im Kwon-taek a tenté dans son style d’atteindre des choses rares, l’essence de l’esprit coréen, qu’on peut résumer par la notion de mouvement dans l’immobilité. C’est difficile à saisir, tout en contradictions : le film semble statique alors qu’il est presque syncopé. Les plans sont fixes mais vibrants, vifs. La peinture est filmée comme un mouvement très physique. L’histoire mouvante croise des personnages qui n’ont pas changé, etc… Ces choses antinomiques ne se marient pas toujours bien, c’est ce qui donne cette impression étrange. Belle tentative, tout de même. Et la fin, poétique et en même temps très sèche, est une des idées de la mort les plus saisissantes jamais vues. Ce 99ème film semble un petit Im Kwon-taek, qui peut faire penser à tort que ce cinéaste est académique, mais cela peut faire un objet d’étude fascinant.
Ivre de Femmes et de Peinture n'est pas mauvais. C'est même un excellent Im Kwon Taek. N'empêche, il appartient à cette catégorie de films grandioses sur le papier qui à force de vouloir trop bien faire perdent un peu de la puissance instinctive (la fameuse force vitale de la création dont parle le film) qui fait les chefs d’oeuvre. Car avec deux des meilleurs acteurs coréens en activité ici à la hauteur de leur talent (Choi Min Sik, Ahn Sung Ki) on pouvait espérér un film qui égalerait La Chanteuse de Pansori ou Mère Porteuse.
 Le film d'Im Kwon Taek ressemble en effet à un gâteau qui perd un peu de son goût à force d'etre surchargé de bons ingrédients. Il contient de nombreuses pistes thématiques intéréssantes: les rapports artistes/mécène, le rapport de l'artiste aux changements historiques, la nature comme source d'inspiration, l'artiste tiraillé entre désir de reconnaissance et volonté de remise en cause permanente de son art, la Corée tiraillée entre l'occupant japonais vu comme une force oppressive et une Chine influente culturellement, la création comme force vitale. On peut avoir à première vue l’impression que ce foisonnement romanesque n'a pas dans le film l'espace suffisant pour se développer, illusion provenant de son montage.
Le film d'Im Kwon Taek ressemble en effet à un gâteau qui perd un peu de son goût à force d'etre surchargé de bons ingrédients. Il contient de nombreuses pistes thématiques intéréssantes: les rapports artistes/mécène, le rapport de l'artiste aux changements historiques, la nature comme source d'inspiration, l'artiste tiraillé entre désir de reconnaissance et volonté de remise en cause permanente de son art, la Corée tiraillée entre l'occupant japonais vu comme une force oppressive et une Chine influente culturellement, la création comme force vitale. On peut avoir à première vue l’impression que ce foisonnement romanesque n'a pas dans le film l'espace suffisant pour se développer, illusion provenant de son montage.

Car bien plus que le Prix de la Mise en scène (la caméra qui suit le regard du peintre et la focale donnent des effets réussis mais attendus), c'est le montage du film qui aurait du etre récompensé à Cannes. Certes, l'interprétation qu'en fait Yann se tient et est cohérente avec le film: le découpage serait le reflet du travail de recherche de l'ame coréenne que font le peintre et le cinéaste (cf le final où Ahn Sung Ki félicite Chi Min Sik pour avoir réussi à capter cette ame par le pinceau). Mais j'en propose une autre: on a l'impression que le film passe abruptement d'une situation à l'autre, qu'il ne se développe pas. Il s'agit plutot du fait que le film passe à une autre situation quand les bases de la précédente ont été posées. Du coup, on en vient à l'idée que les scènes du film seraient une suite de croquis de situations. Qui plus est, les grandes variations rythmiques à l'intérieur du film nous font dire qu'il s'agit de situations plus ou moins développées. Or l'idée d'une suite d'esquisses plus ou moins menées à terme ou abouties renvoie au mécanisme de la création artistique. Im Kwon Taek aurait alors traduit le processus de création d'une façon purement cinématographique. Meme s'il est un peu trop théorique -car dans la pratique du film quand une esquisse de situation est inaboutie le spectateur s'ennuie un peu-, ce choix a le mérite d'être neuf dans le cadre d'une biographie de peintre.
 L’autre limite du film, c’est le problème du lien entre l'artiste et les évènements historiques: le problème est que, si dans le cadre de la peinture de nature à visée réaliste, le lien avec ce qui est peint est direct, il n'en est pas de même vis à vis du contexte historique d'une époque. Un travail de réinterprétation est fait par l'artiste. Du coup, on pense à Andrei Roublev: dans ce film, Tarkovski narrait l'existence d'un peintre d'icônes et montrait comment une oeuvre représentative de l'ame russe naissait au milieu d'une période historiquement agitée. Ce dernier constat pourrait aussi s'appliquer à l'art d'Oh Won qui nait dans le tumulte historique des occupations de la Corée par la Chine et le Japon. Sauf que Tarkovski passait par le cheminement spirituel de son héros pour rendre compte de cette situation, il nous montrait la réinterprétation des circonstances historiques par l'artiste, ce que ne fait pas Im Kwon Taek.
L’autre limite du film, c’est le problème du lien entre l'artiste et les évènements historiques: le problème est que, si dans le cadre de la peinture de nature à visée réaliste, le lien avec ce qui est peint est direct, il n'en est pas de même vis à vis du contexte historique d'une époque. Un travail de réinterprétation est fait par l'artiste. Du coup, on pense à Andrei Roublev: dans ce film, Tarkovski narrait l'existence d'un peintre d'icônes et montrait comment une oeuvre représentative de l'ame russe naissait au milieu d'une période historiquement agitée. Ce dernier constat pourrait aussi s'appliquer à l'art d'Oh Won qui nait dans le tumulte historique des occupations de la Corée par la Chine et le Japon. Sauf que Tarkovski passait par le cheminement spirituel de son héros pour rendre compte de cette situation, il nous montrait la réinterprétation des circonstances historiques par l'artiste, ce que ne fait pas Im Kwon Taek.
Parmi les ingrédients en quantité insuffisante ici pour contrebalancer ces limites des choix du film, on a le sexe et le pansori: le souffle des chants de pansori justement faisait une grande part de la force émotionnelle de la Chanteuse de Pansori et de Chunhyang et si Im Kwon Taek filme avec un plaisir vicieux les scènes de sexe (celle interrompue par l'incendie entre autres) on ne retrouve pas assez souvent ce qui faisait de lui un des auteurs de festival les plus jouissifs avec Imamura. La rigueur des cadrages et la splendeur picturale du film pourraient également évoquer le Kurosawa de la fin. Sauf que l'empereur du cinéma mondial n'oubliait jamais totalement la dimension humaine et la profondeur émotionnelle. Ici, malgré tout le talent de ses acteurs principaux, on est en présence d'une oeuvre trop théorique. L'émotion est le plus souvent aux abonnés absents. Elle est néanmoins assez présente pour donner au film un minimum de grands moments de cinéma. Lors de quelques plans de nature ou lorsque le peintre déchire ses créations par exemple. Elle est également présente dans la scène d'ouverture en forme de métaphore de la peinture comme art qui violente son matériau de travail ou dans le final réfléchissant de façon originale sur la différence artiste/artisan. Et lors des scènes de sexe of course. Au final, si Im Kwon Taek n'égale pas Pialat (les rapports peintre/mécéne en métaphore des rapports Pialat cinéaste/Du Plantier producteur), Clouzot (le Mystère Picasso qui reste le film qui rend le mieux compte du processus de création artistique) ou Tarkovski, son film a le mérite de renouveler le genre de la biographie de peintre et n'a pas à rougir de la comparaison avec les réussites de la relève 2002 du cinéma d'auteur coréen signées Lee Chang Dong ou Hong Sang Soo.
Et pour terminer ma critique une petite "dédicace" aux Coréens qui attribuent la gloire critique et festivalière en Occident de Im Kwon Taek à son "exotisme" et l'accusent de faire des films pour l'Occident: cela fait un peu à mon sens rhabillage au gout du jour des arguments vieux comme l'explosion mondiale de Kurosawa Akira (auquel les critiques japonais faisaient le meme reproche alors que l'Empereur faisait des films enracinés dans le Japon paysan pour le public japonais). Les films de Im Kwon Taek ne sont pas comme La Porte de l'Enfer de Kinugasa conçus à usage externe: dans les thèmes, l'approche esthétique et la mise en scène, il n'y a pas plus profondément coréen que le cinéma d'Im Kwon Taek. Et c'est le fait d'être si profondément enracinée dans sa nation qui donne à son oeuvre son caractère universel.

Le parallèle que IM Kwon-taek fait dans ce film entre la peinture et son cinéma ne serait-ce déjà que par le découpage des scènes et la photographie montre à coup sûr une belle maîtrise technique. Si on conçoit que cet aspect ne vient pas entâcher la narration mais au contraire la réhausse par une mise en perspective des deux formes d'arts, il serait logique de considérer ce film comme indispensable.
Le problème (éventuel) pour le spectateur vient de la trop grande visibilité de la construction que rend plus évident encore le rythme assez lent du film. Du coup, on bascule sans cesse entre dans le jugement, non pas de ce que Im Kwon Taek nous propose, mais du choix technique et esthétique de celui-ci, et l'histoire elle-même. Cette mise à distance est-elle volontaire? Difficile à dire, mais le film évolue du début à la fin dans cet équilibre précaire qui nécessite de la part du spectateur au moins une certaine attention, sinon un effort. Chihwaseon ne fait donc pas parti de ces films faciles, et si cela est tout à l'honneur de Im Kwon Taek, cette construction semble quand même ôter au film une bonne partie de d'implication émotionnelle au profit d'une intellectualisation de l'art qui semble en contradiction avec le propos même de la vie de Jang Seung Up.
 Je ne pourrais comparer ce portrait de peintre signé Im Kwon-Taek avec les 2 références en la matière que sont Van Gogh (Pialat) et Le mystère Picasso (Clouzot), faute de les avoir vus. Je pourrais en revanche l’étalonner sur 3 autres films mettant en scène des artistes peintres : Basquiat, Rembrandt et le court métrage de Rêves avec Scorsese. Ivre de femmes… est à mi-chemin entre ces œuvres : tantôt inventif et généreux lorsqu’il s’agit de croquer une époque et un personnage haut en couleur, tantôt austère dans la description de l’inspiration de l’artiste (on est loin des visions de sports maritimes de Jean-Michel Basquiat quand il lève les yeux au ciel). C’est en cela que l’on peut dire que son film est plutôt académique, parce qu’il peine à nous faire entrer dans l’esprit dérangé d’Ohwon.
Je ne pourrais comparer ce portrait de peintre signé Im Kwon-Taek avec les 2 références en la matière que sont Van Gogh (Pialat) et Le mystère Picasso (Clouzot), faute de les avoir vus. Je pourrais en revanche l’étalonner sur 3 autres films mettant en scène des artistes peintres : Basquiat, Rembrandt et le court métrage de Rêves avec Scorsese. Ivre de femmes… est à mi-chemin entre ces œuvres : tantôt inventif et généreux lorsqu’il s’agit de croquer une époque et un personnage haut en couleur, tantôt austère dans la description de l’inspiration de l’artiste (on est loin des visions de sports maritimes de Jean-Michel Basquiat quand il lève les yeux au ciel). C’est en cela que l’on peut dire que son film est plutôt académique, parce qu’il peine à nous faire entrer dans l’esprit dérangé d’Ohwon.
Im Kwon-Taek préfère ainsi privilégier les nombreuses scènes de peinture proprement dites et l’évolution de la vie du personnage principal ; cela donne lieu à certains moments superbes où on le voit peindre sur une toile de soie déposée à même le sol tandis que des musiciens composent des mélodies orientales magnifiques. La fragilité des œuvres créées est souvent mise en avant : chiffonnage, coups de poignards et déchirage de toiles sont le lot quotidien des sautes d’humeur alcooliques ou perfectionnistes d’Ohwon. Parallèlement, une réflexion sur le sens de la vie est amenée au fil du récit. En effet, le peintre est très doué mais se contente d’exécuter des commandes standardisées (genre « fleur et oiseau ») de riches commerçants ou de hauts fonctionnaires ; cela lui donne certes un statut confortable et une large reconnaissance, mais son âme d’artiste est frustrée. Seules les différentes femmes qu’il rencontre lui redonnent l’inspiration et la volonté de bouleverser l’ordre préétabli et les conventions régissant l’art coréen, d’où sa petite phrase, « si je ne bande pas, je ne peux créer ! ».
Il y a de la philosophie zen dans ce film, histoire d’un artiste non accompli ballotté dans une époque tourmentée (le XIXème siècle). S’il n’apporte pas forcément grand chose de nouveau, il permet de se plonger avec délice dans l’art pictural oriental si peu connu dans nos contrées, grâce à une mise en scène étonnement energique récompensée à Cannes en 2002 et un Choi Min-Sik impeccable.

 Si il n'y avait que les extérieurs de nature... sublimes et omnipotents, la musique... discrète et divine, les femmes... hypnotiques, les peintures... toutes plus belles les unes que les autres, il s'agirait déjà d'une grande oeuvre esthétique... Bien plus encore, la pureté transperce Ivre de femmes et de peinture de part et d'autre pour ne rien laisser d'ostentatoire et de superficiel.
Le moindre plan y est transcendé en oeuvre toute puissante et le contexte historique semble se dérouler à des années-lumières du monde dans lequel vit ce peintre par excellence. Étant (petit) peintre à mes heures, je ne peux nier que ce film m'a transpercé le coeur tant la justesse du propos, la simplicité et la véracité de chaque parole touche à l'étincelle de vie.
Si il n'y avait que les extérieurs de nature... sublimes et omnipotents, la musique... discrète et divine, les femmes... hypnotiques, les peintures... toutes plus belles les unes que les autres, il s'agirait déjà d'une grande oeuvre esthétique... Bien plus encore, la pureté transperce Ivre de femmes et de peinture de part et d'autre pour ne rien laisser d'ostentatoire et de superficiel.
Le moindre plan y est transcendé en oeuvre toute puissante et le contexte historique semble se dérouler à des années-lumières du monde dans lequel vit ce peintre par excellence. Étant (petit) peintre à mes heures, je ne peux nier que ce film m'a transpercé le coeur tant la justesse du propos, la simplicité et la véracité de chaque parole touche à l'étincelle de vie.
Le vide mélancolique et insaisissable contraste avec extase le nombre incroyable de plans, comme si Im Kwon Taek peignait à son tour la vie au gré de son héros ténébreux tiraillé entre la reconnaissance et la richesse (généralement vite engloutie dans l'alcool) que lui valent son talent et son interminable quête de l'émotion jetée sur le papier.
Le vide et le plein, l'essence même de la peinture sont ici transmis dans toute leur perfection. L'assemblée qui regarde Choi Min Sik peindre pourra être aussi perplexe que le spectateur à la découverte de ces étranges peintures monochromes. Et pourtant toute la force discrète, presque cachée, de la peinture est là, l'équilibre sensoriel entre le plein et le vide, l'intuition d'une tache noire qui remplit un espace que nul ne décide, si ce n'est l'écoute de l'énergie de l'instant. Quelque chose de très difficile à expliquer qui est ici parfaitement catalysé au travers de la moindre parcelle de pellicule.
La mélancolie, la rage et l'extase de l'hypnose ne font qu'un dans la vie de ce peintre hors du commun. La fougue et la folie destructrice d'un Basquiat côtoient la technique incroyable et le bagage culturel des peintres asiatiques de cette époque. Le tout bouillonne comme jamais malgré le calme apparent.Ivre de femmes et de peinture est un hymne à la beauté, à la culture et à la recherche de l'insaisissable, une oeuvre bouleversante de sincérité. C'est un de ces films qui devrait être connu et vécu par le plus grand nombre tant il respire de toute son âme. Un film qu'il faut voir et SURTOUT revoir.
Plus encore, le DVD Pathé est superbement présenté et le malheureusement trop court reportage sur les manifestations des cinéastes coréens (dont Im Kwon Taek), en 1999, face à la diminution des quotas de diffusion et la main mise des États-Unis sur la programmation cinématographique, termine de nous anéantir de par son engagement profondément primordial.
Il résonne d'autant plus fort que ce combat pour l'épanouissement et simplement la survie de la culture cinématographique coréenne rappelle avec insistance celui qui se mène aujourd'hui dans notre pays. Le sujet n'est pas le même mais l'action de ces artistes est intimement liée aux raisons qui poussent NOS intermittents à se faire entendre. La culture nourrit chaque pays et est universelle, elle est le ciment qui peut tous nous grandir si on sait la reconnaître et la soutenir. Les regards graves et tristes de ce reportage, qui s'arrête malheureusement à l'année 1999, sont les mêmes que ceux des français qui se battent actuellement pour que l'exception culturelle ne soit pas un vain mot.Aujourd'hui, ce combat pour un quotas de diffusion de films coréens décent est encore et toujours d'actualité puisqu'après les très bons chiffres des années 2000-2001-2002 et l'âpre victoire des cinéastes nationaux en 1999, le problème des quotas est à nouveau mis sur la table en ce mois de juin 2003 avec notamment des pressions toujours plus fortes de la MPAA (Motion Picture Association of America), organisation gestionnaire des intérêts des majors américaines, et un gouvernement coréen fébrile qui réfléchit encore aujourd'hui à la suppression pure et simple de ces quotas vitaux pour la survie d'un vrai cinéma national (rassurés qu'ils sont par les bénéfices plutôt rondelés des grosses machines), et malgré la présence de Lee Chang-Dong (réalisateur d'Oasis et de Peppermint candy) en tant que ministre de la culture de plus en plus esseulé et menacé.
Une raison de plus pour réfléchir à (et même boycotter) l'influence du mode de pensée globale américain, formaté, sans saveur ni odeur, faisant de nous des vaches à lait saturées d'inutile. Célébrons plutôt l'essentiel : fleurs et oiseaux. Et que ceux qui ne comprennent pas ouvrent grand leurs receptacles devant ce film profondément global.


