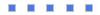

| Ordell Robbie | 3 | Tu n'as rien vu à Hiroshima... |
| MLF | 3.5 |
Durant les années 60-70, Yoshida Yoshishige fut l'une des figures de proue de la Nouvelle Vague nipponne. Sans nier l'importance historique de ces films, il apparaît pourtant que ses classiques de l'époque n'ont pas passé l'épreuve du temps sans heurts. Par leur travail absolument unique sur le cadre et leurs audaces formelles, ces derniers sont emblématiques du bouillonnement créatif du cinéma mondial de leur temps. Mais ils sont malheureusement aussi émblématiques des travers de cette époque, celle de la mode des idéologies, celle où une partie de la jeunesse arborait ses références aux "penseurs engagés" comme d'autres arborent aujourd'hui un sac Vuitton : les références intellectuelles mal digérées et la tendance à asséner son propos avec des moyens légers comme une enclume. De ce point de vue, son célèbre Eros plus Massacre, chef d'oeuvre de sa première partie de carrière, exacerbe la grandeur et les travers des Yoshida de cette période: les allers-retours temporels d'une structure narrative en forme d'hommage réussi à Vivre de KUROSAWA, le dispositif formel conciliant une théâtralité toute japonaise et l'héritage des Nouvelles Vagues européennes racontaient bien mieux le Japon de la fin des années 60 que la pose auteurisante de certains passages scénaristiques du film. YOSHIDA retrouvera ensuite en partie cette verve-là avec un Coup d'Etat en forme de point final de cette première période artistique du cinéaste. A l'instar de celles de quelques autres de ses contemporains de la Nouvelle Vague (OSHIMA, TESHIGAHARA, SHINODA), la seconde partie de carrière de YOSHIDA sera marquée par un retour à un certain classicisme formel. S'inscrivant dans cette veine, Femmes en miroir évite le didactisme sans pour autant totalement convaincre.
 Avec Femmes en Miroir, Yoshida offre un beau film sur le traumatisme d'Hiroshima aux qualités indéniables mais qui souffre de passer après ceux d'autres maîtres nippons (Shindo, Kurosawa) et même après un film choc de la jeune garde japonaise des années 90 (Suwa). La force et la limite du film de Yoshida est de contenir les qualités attendues chez un "film de grand maître japonais": lenteur contemplative, refus de toute dramatisation, retenue, sens de l'ellipse, mise en scène classique aux effets très calculés. Cette impression est encore renforcée par la présencen de Okada Mariko, actrice fétiche d'Ozu et compagne du cinéaste. La première partie du film comporte des parti pris de mise en scène intéréssants: le jeu sur le miroir brisé qui devient la part manquante à la fois dans cette famille nipponne typique et dans l'histoire du Japon, le superbe usage des ellipses lors de la scène d'ouverture en forme de chassé croisé entre une voiture et une vieille dame n'abandonnant jamais son parapluie même au soleil, les plans de rétroviseur recoupant le travail du film sur la notion de reflet déformé. Sauf que si le score éxpérimental mêlant pianos et saturation reflète dans cette partie pré-Hiroshima une étrangeté derrière une surface lisse qui ne demande qu'à refaire surface, il demeure pénible pour l'oreille du spectateur. Quant à la photographie, son côté trop terne nuit à l'émotion là où il voufrait être symbole d'effacement de toute esthétisation visible face à ma gravité du sujet. Surtout, cette partie s'étire trop en longueur d'un point de vue rythmique. Jusque là, on est en présence d'une oeuvre très maîtrisée, mais où l'exçès de contrôle du cinéaste finit par étouffer toute émotion. Certains diront à raison que la maîtrise est ce qui caractérise les chefs d'oeuvre mais le cinéma ne vaut rien si cette maîtrise n'est pas accompagnée de la dimension humaine.
Avec Femmes en Miroir, Yoshida offre un beau film sur le traumatisme d'Hiroshima aux qualités indéniables mais qui souffre de passer après ceux d'autres maîtres nippons (Shindo, Kurosawa) et même après un film choc de la jeune garde japonaise des années 90 (Suwa). La force et la limite du film de Yoshida est de contenir les qualités attendues chez un "film de grand maître japonais": lenteur contemplative, refus de toute dramatisation, retenue, sens de l'ellipse, mise en scène classique aux effets très calculés. Cette impression est encore renforcée par la présencen de Okada Mariko, actrice fétiche d'Ozu et compagne du cinéaste. La première partie du film comporte des parti pris de mise en scène intéréssants: le jeu sur le miroir brisé qui devient la part manquante à la fois dans cette famille nipponne typique et dans l'histoire du Japon, le superbe usage des ellipses lors de la scène d'ouverture en forme de chassé croisé entre une voiture et une vieille dame n'abandonnant jamais son parapluie même au soleil, les plans de rétroviseur recoupant le travail du film sur la notion de reflet déformé. Sauf que si le score éxpérimental mêlant pianos et saturation reflète dans cette partie pré-Hiroshima une étrangeté derrière une surface lisse qui ne demande qu'à refaire surface, il demeure pénible pour l'oreille du spectateur. Quant à la photographie, son côté trop terne nuit à l'émotion là où il voufrait être symbole d'effacement de toute esthétisation visible face à ma gravité du sujet. Surtout, cette partie s'étire trop en longueur d'un point de vue rythmique. Jusque là, on est en présence d'une oeuvre très maîtrisée, mais où l'exçès de contrôle du cinéaste finit par étouffer toute émotion. Certains diront à raison que la maîtrise est ce qui caractérise les chefs d'oeuvre mais le cinéma ne vaut rien si cette maîtrise n'est pas accompagnée de la dimension humaine.

Heureusement, malgré quelques longueurs encore présentes, le film finit par se trouver lorsqu'il décide enfin de se rapprocher de la source de l'horreur. A partir du départ à Hiroshima, le film va pouvoir offrir quelques grands moments de cinéma: le score expérimental va trouver dans la scène du souvenir du meurtre que la kidnappeuse croit avoir commis un écrin parfait pour déployer une impression d'effroi, d'étrangeté; les lieux font renaître une horreur d'autant plus forte qu'elle ne passe que par la parole; quelques ombres sur une porte font réapparaître le souvenir d'un enfant, la scène où un coucher de soleil nimbe la pièce d'une lumière couleur sang est également magnifique. La question de l'Amérique dans le film est également révélatrice des fondements de la culture nipponne: une culture qui prend l'étranger comme point de référence (ce qui explique qu'un Kitano n'eut de reconnaissance à domicile qu'après sa gloire vénitienne) tout en estimant que ce qui est typiquement japonais est incompréhensible pour l'étranger. Dans le film, l'Amérique est à la fois très proche (le soldat irradié, le compagnon de l'autre côté du Pacifique) mais cantonnée au hors champ et Natsuki préfèrera au final son identité de femme japonaise à sa part occidentale une fois que le lien manquant entre la famille japonaise traditionelle (Ai) et la jeunesse nipponne contemporaine incarné par Masako refera surface. Le traumatisme d'une famille et sa résolution se met alors à coïncider avec celui d'une nation, Yoshida usant alors de l'ellipse pour laisser sa liberté d'interprétation au spectateur pour ce qui est de la fin du film.
Sauf qu'à un maître qui finit par nuire à l'émotion en faisant une surenchère de retenue et de classicisme attendu, à un film certes digne mais pas aussi poignant qu'il pourrait l'être (et la retenue bien utilisée peut parfois être poignante), on peut préférer l'avant-dernier souffle d'un Kurosawa qui osa convoquer l'Amérique dans son champ cinématographique pour lui faire ressentir l'horreur atomique ou la turbulence d'un Suwa qui utilisait la corps félin de Béatrice Dalle pour revisiter l'héritage de Resnais. Dans les deux cas, les cinéastes osaient se confronter au regard de l'Autre. Regard qui manque cruellement ici.


