Un classique du chambara glacial
Ce beau chambara, offrant à Nakadai Tatsuya un rôle à la hauteur de son talent, est l'un des films les plus personnels de Gosha puisque l'on y trouve un peuple opprimé par les hautes autorités, un héros solitaire dévoré par son passé mal négocié, un chambellan désirant l'évincer parce qu'il se mêle des affaires qui ne le regarde pas, des femmes amoureuses, des espions aveuglés par l'argent, un système qui ne laisse pas de seconde chance. Goyokin se déroule principalement dans des plaines, tantôt sèches tantôt enneigées, donnant ainsi un aspect mortuaire aux environnements, accentué par l'omniprésence des corbeaux, oiseaux de malheur qui donnent tout la signification au terme "d'épouvante" en début de métrage, avec une Oriha revenant au pays et ne trouvant que silence, mort et glace. Le climax d'intro va d'ailleurs être prolongé sur presque toute la durée du film, le jeu impassible de Nakadai, l'obsession de "tuer" d'un Natsuyagi Isao, la musique typée western de Sato Masaru évoque elle aussi la mort, la préparation d'une cérémonie funèbre, celle que l'on pouvait entendre chez Corbucci ou Leone au son des castagnettes. Ce mariage d'influences occidentales et de solidité chambaresque donne une certaine importance à Goyokin sur le plan cinématographique, car s'il reste un chambara tout ce qu'il y a de plus classique, à tendance humaniste dans les propos mais bien plus sauvage dans l'exécution, sa mise en scène témoigne d'une remarquable souplesse notamment dans la pléthore des combats au sabre, d'une violence redoutable sans faire montre d'une seule envolée gore, là où un Hitokiri ne se laissera pas prier rayon étalage de morts graphiques. Globalement exempt de tout reproche, Goyokin aurait néanmoins pu se terminer plus tôt, les dix dernières minutes sous les tam-tam festifs paraissent trop étendus sur la longueur et le plan final montrant Magobei et Oriha s'en aller vers des contrées lointaines ne fait pas dans l'originalité.
Somptueux chambara 
Grand film d’aventures crépusculaire sublimé par le charisme naturel d’un NAKADAI Tatsuya barbu en grande forme, par une musique entêtante et par un final contemplatif ahurissant dans la neige, hors du temps, avec ces masques et ces tambours qui annoncent la fin de la partie,
Goyokin marque les esprits en tant que classique du chambara proche des éléments de la nature, de la forêt, des animaux, du froid, du vent, de la neige et de l’être humain dans son ignominie comme dans sa dignité. Essentiel.
Superbe maîtrise formelle... mais déception aussi. 

Une trame historique intéressante, une atmosphère décrépie qui respire la fin des samourais et les grands westerns aux héros désenchantés (
Le grand silence sans hésitation) mais un scénario tout de même trop simpliste et un seul véritable enjeu qui décuple la lenteur malgré la grandiose mise en scène de Gosha. Moins puissant que
Sword of doom par exemple, dans sa dénonciation du système féodal. Déception même si le film reste un grand classique superbement maîtrisé, que tous les acteurs sont phénoménaux (la prostituée, incandescente) et Tatsuya Nakadai est impérial comme d'habitude.
Du grand Gosha
 Avec Goyokin, Hideo Gosha signe une réussite majeure du cinéma de sabre des années 60, celui où les mercenaires ont remplacé les héros humanistes kurosawaiens. Mine de rien, les 2 heures du film passent sans que l'on s'en rende compte et l'on éprouve un plaisir identique à celui ressenti en regardant un Sergio Leone des débuts ce qui n'est pas la pire des références.
Avec Goyokin, Hideo Gosha signe une réussite majeure du cinéma de sabre des années 60, celui où les mercenaires ont remplacé les héros humanistes kurosawaiens. Mine de rien, les 2 heures du film passent sans que l'on s'en rende compte et l'on éprouve un plaisir identique à celui ressenti en regardant un Sergio Leone des débuts ce qui n'est pas la pire des références.
Comme beaucoup de films de sabre de cette époque, Goyokin se situe à la fin du dix-neuvième siècle, à l'époque où le Shogun est très contesté et où les samourais deviennent mercenaires. Après la mise en situation de l'introduction, nous voyons une jeune femme arriver dans une cabane entourée et infestée de corbeaux où elle découvrira le corps de son futur époux: Gosha nous offre déjà un moment de terreur pur qui n'a rien à envier aux Oiseaux d'Hitchcock. A ce stade, nous ne savons rien sur les personnages et le film replace l'événement dans une série d'évaporations (disparitions sans laisser de traces) ayant eu lieu à cette époque. Le film continue trois ans après à Edo. Les informations sur tous les personnages nous seront alors communiquées au travers d'une série de flash-backs qui explicitent la cruauté du clan Sabai, les motivations des personnages féminins ainsi que les regrets du héros (qui regrette sa passivité lors du massacre des pecheurs). Gosha va alors nous offrir le portrait d'un samourai qui a choisi de croire encore en l'honneur dans un monde où il a été remplacé par l'argent et de s'opposer seul à tout un clan, le sien propre. Et Tatsuya Nakadai met toute son énergie et son talent à incarner ce personnage envahi par les remords de n'avoir pas réussi à empecher un massacre et prêt à tout pour mettre un terme à la cruauté de son clan.
 Surtout, Goyokin regorge de superbes idées de mise en scène: l'ouverture où la caméra suit le mouvement des vagues, le générique à la photographie couleur or, les nombreux plans où l'on ne voit que le visage de Nakadai dans l'obscurité comme pour montrer qu'il se sent un fantôme dans ce monde (il dira d'ailleurs: "ils peuvent me tuer, je suis déjà mort le jour où j'ai laissé périr les pécheurs" comme s'il était déjà mort en tant que samourai), l'attention aux détails (gros plans sur les yeux, le trou dans un mur), l'utilisation de la neige, de la pluie, de l'obscurité et des incendies lors des magnifiques combats au sabre, les plans distants durant ces combats ou lors de certaines scènes de dialogue afin de créer le suspense sur leur issue, la combinaison de travellings hypnotiques et de zooms pour montrer un détail du décor, l'intrusion d'une scène typiquement western (la joueuse de dés traînée à terre à l'aide d'une corde tenue par un cavalier), l'exploitation réussie du cadre des rivages d'Hokkaido lors des scènes finales du film, l'alternance duel au sabre/plans sur les musiciens portant des masques traditionnels et jouant du tambour qui donne un rythme et une intensité accrus au duel final. La musique de Masaru Sato combine l'esprit de sa partition pour Yojimbo avec une superbe utilisation des cordes.
Surtout, Goyokin regorge de superbes idées de mise en scène: l'ouverture où la caméra suit le mouvement des vagues, le générique à la photographie couleur or, les nombreux plans où l'on ne voit que le visage de Nakadai dans l'obscurité comme pour montrer qu'il se sent un fantôme dans ce monde (il dira d'ailleurs: "ils peuvent me tuer, je suis déjà mort le jour où j'ai laissé périr les pécheurs" comme s'il était déjà mort en tant que samourai), l'attention aux détails (gros plans sur les yeux, le trou dans un mur), l'utilisation de la neige, de la pluie, de l'obscurité et des incendies lors des magnifiques combats au sabre, les plans distants durant ces combats ou lors de certaines scènes de dialogue afin de créer le suspense sur leur issue, la combinaison de travellings hypnotiques et de zooms pour montrer un détail du décor, l'intrusion d'une scène typiquement western (la joueuse de dés traînée à terre à l'aide d'une corde tenue par un cavalier), l'exploitation réussie du cadre des rivages d'Hokkaido lors des scènes finales du film, l'alternance duel au sabre/plans sur les musiciens portant des masques traditionnels et jouant du tambour qui donne un rythme et une intensité accrus au duel final. La musique de Masaru Sato combine l'esprit de sa partition pour Yojimbo avec une superbe utilisation des cordes.
Au final, les personnages contemplent un monde en ruine et Gosha nous offre un grand film de sabre nostalgique et pessimiste.
Chambara Doré
La vision de ce film commence a dater un peu. Si j’ai attendu aussi longtemps pour poster ma critique, c’est en grande partie par flemme je l’avoue, mais aussi car certains films ont besoin de murir en tête pour livrer leur plein potentiel. Ce n’est pas une vision mais une réflexion qui leur permette de se révéler pleinement. Goyokin est de cette trempe.
Les précédents films de Gosha que j’ai vus étaient annonciateurs de ce qu’allait être Goyokin.
Comme le laissais apparaitre 3 Samourais Hors-la-loi, l’ère dépeinte ici est celle d’un Japon au bord du gouffre, où l’honneur n’est qu’un lointain souvenir perdu depuis longtemps. Un Japon en pleine déliquescence qui fascine Gosha qui en fera la pièce maitresse de l’ensemble de son œuvre. Ce constat est ici d’autant plus palpable puisqu’en toile de fond est évoqué l’arrivée des américains sur les terres nippones. Un événement majeur dans l’histoire du pays puisqu’il aboutira a la chute de l’empire et a l’ouverture vers l’étranger. Un univers désenchanté dans lequel toute la féodalité est remise en cause, en particulier les samouraïs dont les jours sont comptés et ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes. Ils n’y sont que bêtes de foire (c’est ainsi qu’apparait Magobei, se donnant en spectacle, prêt a vendre son sabre) ou brigands servant leurs propres intérêts, loin du code d’honneur oublié depuis longtemps.
Tel Gennosuke dans Le Sabrede la Bête, Magobei s’oppose, après trahison, à son ancien clan. Pour lui, il est mort après le massacre des pêcheurs du village. Il cherchera la rédemption en empêchant de nouveau le même massacre. Il ira jusqu'à s’opposer a son ancien clan pour tirer un trait définitif sur son passé et se tourner vers un avenir qu’il sait sombre.
De même que dans Samourai sans Honneur, la motivation principale de la quête est la richesse pécuniaire (dans ce dernier, une jarre contenant 1 million de Ryo, ici un navire rempli d’or). Mais a la différence de Tange Sazen qui croisera dans sa quête nombre de personnages hauts en couleur, Magobei, désabusé par le monde qui l’entoure, ne rencontrera que bandits, voleurs, sombres ronins et peu de personne de bonne foi. Les plus humbles personnes qu’il verra sont les petites gens, les pécheurs sacrifiés sur l’autel du gain, les seuls non corrompus par ce système féodal gangréné de toute part.
Les paysages sont représentatifs du constat de Gosha. Entre villages détruits et apocalyptiques et plaines enneigées désertiques, ils sont a l’image des personnages qui traversent le film : désolés. Et s’il est un acteur qui pouvait coller au mieux au personnage de Magobei, ce ne pouvait être que Tatsuya Nakadai. Il a déjà prouvé ses qualités immenses d’acteurs, mais ici il les transcende pour ne former qu’un avec son double. Sa meilleure prestation que j’ai vue a ce jour pour le moment (dont le port de la barbe lui donne une allure iconique très classe). Bien sûr les seconds rôles ne sont pas en reste avec notamment Tetsuro Tamba et Kinnosuke Nakamura, déjà habitués de Gosha.
Gosha qui fait preuve encore une fois d’une science du cadre extraordinaire. Outre les paysages magnifiés en Panavision, une première nationale, il livre des combats sans fioritures, avec un cadre net et précis, sans coupe. Il suffit de voir ces combats en plan séquence où tout est compréhensible pour s’en rendre compte. Gosha arrive a magnifier ses personnages et a les mettre en valeur. On sent a travers sa mise en scène qu’il comprend ses protagonistes et leur mœurs. Bien sûr le tout est accompagné d’une musique superbe de Masaru Sato, qui accompagne parfaitement la plupart des scènes.
Bref, avec ce Chambara hors norme, Gosha signe un film nihiliste sur la fin d’une ère. Je pense que la note montera toute seule lors de la seconde vision.
L'Or Blanc 
69, année érotique, disait Jane Birkin. Mais pas seulement: année qui verra la sortie de
Goyokin et
Hitokiri, deux chefs-d’œuvre d’Hideo Gosha, deux chanbara atteignant un certain point de non-retour dans le genre dont la mutation s’achèvera au début de la décennie suivante avec entre autres la série des
Baby Cart.
Goyokin, l’Or du Shogun qui nous intéresse ici ne dépareille pas nécessairement au sein de la production de films de sabre de son époque – thématiquement comme stylistiquement – mais il en constitue sans nul doute un des plus beaux achèvements. Si les quelques lenteurs de la première partie et la mise en place un brin confuse de l’intrigue peuvent dérouter, l’ensemble fait montre dès les plans initiaux d’une force visuelle et atmosphérique peu commune avec son introduction en voix-off sur la musique envoûtante de Masaru Sato et la sordide découverte d’un village de pêcheurs décimé par une horde de guerriers, annonciatrices d’un grand film homérique. Cette entrée en matière ne mentait pas, le spectacle étant une fois les enjeux posés total: l’affrontement dans une cabane en feu qui oppose le protagoniste Magobei (impeccable Tatsuya Nakadai) à des membres du clan Sabaï auquel il avait appartenu, le héros luttant pour sortir d’un trou sous la neige dans lequel il est tombé ligoté, la longue bataille nocturne autour d’un récif et le duel à mort entre Magobei et Tatewaki (énigmatique Tetsuro Tamba), plusieurs morceaux de bravoure qui n’auraient probablement pas constitué le dixième des péripéties d’un wu xia pian de Hong Kong ou d’un film d’aventures hollywoodien mais que Gosha filme avec une intensité et un souffle épique extraordinaires, rendant par la même occasion hommage à Sergio Corbucci via ces décors aussi bien boueux (
Django) qu’enneigés (
Le Grand Silence) dans lesquels évoluent les personnages. Du western spaghetti, l’influence est d’ailleurs omniprésente, dirait-on à s’y méprendre si le sabre et le hakama ne se substituaient pas au colt et au cache-poussière. Cet environnement pourri et décadent, peuplé de justiciers taciturnes, d’autocrates sanguinaires et de femmes meurtries, rappelle étrangement celui d’un Ouest qu’on recréait dans les plaines d’Almeria, à l’heure où les édifiantes épopées de John Ford n’étaient plus. Pourtant, la très belle scène finale qui commençait sous des airs d'
Im a poor lonesome samurai se termine sur une note d’optimisme, notre cow-boy de l’île de Sado ne s’éloignant pas seul. Il y a quand même à un moment ou un autre le reflet du soleil dans le sang et la vase. Kurosawa et Kobayashi ont ouvert la brèche à une nouvelle forme de chanbara; Gosha l’a transcendée. Qu’il en soit fait shogun.
Samurai at world's end! 
Le western, le désespoir, la mort, la déréliction, la misère... Gosha!
Goyokin, c'est la manifeste du grand rien, du grand vide, du grand froid, de la faim et de la soif de l'or.
Goyokin c'est un grand apétit qui se bouffe les tripes, s'épuise à courir après son ombre.
C'est le rêve d'un passé qui n'en est pas vraiment un, le cauchemar d'un présent qui est toujours déjà passé.
C'est la peur du vide, le vertige devant le néant, le nulle-part et sa conjuration.
C'est un grand film sans substance dans un monde désincarné.
Déception...
Oui le film est superbement réalisé, oui c'est une oeuvre originale (disons plutot que la somme des éléments qui le constituent le sont mais non les éléments eux-mêmes) mais je ne peux m'empécher de le trouver laborieux. Des longueurs, des ajouts peu utiles (je ne comprends définitivement pas ce qu'apporte la scène des oiseaux... je ne remets pas en cause sa qualité mais elle me fait l'effet d'un court métrage inséré) et une performance pas si bonne de l'acteur... me gâchent le plaisir. A mes yeux encore un classique surestimé mais tout de même à voir (ne serait-ce que pour l'histoire du cinéma). Bref un film plus intéressant que bon.
Chambarra crépusculaire 
Le film commence très fort, on ne sait pas vraiment dans quel genre de film nous sommes !
Ensuite, on nous présente les personnages : ils sont tous remplis de regrets et de tristesse, chacun selon leur histoire, leur caractère et aussi leur 'rang' social. Les acteurs sont vraiment excellents, ils arrivent à faire ressortir ce point commun, tout en jouant totalement différemment, puisque justement chaque personne est différent (plus particulierement, Tatsuya Nakadai et Ruriko Asakoa).
Le film est accompagné d'un somptueuse musique, et l'éclairage est vraiment super.
Le tout se passant dans des décors naturels qui collent complétement à l'histoire (la côté avec mer agitée, des paysages eneigés, un village sous la pluie avec plein de boue), c'est joli sans tombé dans le contemplatif.
Alors bien sûr, qui dit chambarra, dit combats : ils sont variés : duel à la loyal, 1 contre 10, en extérieur, en intérieur avec espace réduit (vieille cabanne), en extérieur avec espace réduit (dans les bois), bref, les combats sont bien présents.
Bon, par contre, je reproche surtout une grosse grosse invraissemblance (spoiler : lorsque Magobei se libere dans la derniere partie)
Sinon, la réalisation est aussi varié, et certains évenements viennent nous surprendre : un très bon film donc.
Western Chambara
Etrange hybride entre le genre chambara et le western (plus particulièrement transalpin des années '60s), Gosha réalise un chant de cygne très personnel aussi bien par rapport à une période historique (la fin du shogunat avant l'avènement de la modernité sous le règne de l'Empereur Meiji), que par rapport au déclin du genre du jidai geiki (film historique).
Personnages et paysages désolés marquent tous deux la fin d'une époque, magnifiquement symbolisé par l'enterrement final sur la plage et les dernières paroles du film.
Gosha trouve largement son compte dans la substitution du support Panavision au profit des anciennes caméras américaines Mitchell pour lui permettre une meilleure maniabilité des caméras, jouer sur des effets de zoom et magnifiquement mettre en scène de grandioses paysages.
Fin des samouraïs, les personnages désœuvrés sont soit prêts à ranger définitivement leur sabre ayant perdu tout sens de la valeur, soit des ronins criminels pour éponger leurs dettes; personnages bien loin de la vision humaniste de Kurosawa ayant relancé le genre en début des années '60s.
S'apparentant aux westerns transalpins de la même époque pareillement désenchantes, Gosha s'inspire autant d'illustres modèles (Hitchcock pour la scène d'ouverture avec les corbeaux; Leone pour l'utilisation du cadre), qu'il n'inspirera de réalisateurs par la suite (Corbucci, Fulci, Bava pour leurs westerns nihilistes).
Un très grand chambara noir empreint d'une infinie tristesse.
Une grande histoire, une vaie légende !
Goyokin fait partie de ces grandes histoires de samouraïs aux destins exceptionnels. Une aventure qui nous plonge à 100% dans l'ambiance de l'époque. Une époque qui, comme souvent dans les chambaras que j'ai pu voir, se situe entre 1830 et 1880, les dernières heures du shogunat (50 années si riches pour les scénaristes de films de sabre japonais).
Le héro, WAKIZAKA Magobei, n'est donc comme à l'accoutumée ni plus ni moins qu'un excellent sabreur, à la morale sans faille et aux valeurs ancestrales. Son déchirement entre l'amitié pour son ennemi et sa cause charitable va lui donner un côté humain qui manque parfois cruellement aux films du genre. Il n'est d'ailleurs pas invincible, il n'embroche pas une douzaine d'adversaires en un coup, il transpire et se blesse comme tout le monde. Bref un personnage intéressant, et par conséquent, un rôle délicat que NAKADAI Tatsuya interprète convenablement, mais... il lui a manqué son charisme habituel ! Eh oui, et c'est surement mon seul bémol mais j'ai trouvé que NAKADAI n'avait pas sorti le grand jeu comme dans Le Sabre du Mal par exemple, au final le film se cherchait un héro qui manquait un peu de présence.
La mise en scène est quand à elle splendide, GOSHA Hideo maîtrise son film du début à la fin, pas une seule fausse note.
Pour conclure, j'ai donc beaucoup aimé Goyokin, un film à voir sans aucun doute, mais personnellement il m'a manqué l'icône fascinante de tout chambara qui se respecte ; peut-être que j'en ai trop attendu de NAKADAI mais bon, connaissant un peu l'acteur... je sais qu'il est capable de nous crever l'écran tout autant qu'un MIFUNE Toshiro !
Sinon, j'ai aussi particulièrement adoré la petite note qui clos le film sur une morale amère, exactement comme dans Les Sept Samouraïs :
- "C'est la fête !"
- "La fête ? Non, un enterrement. Notre enterrement, à nous, samouraïs."

Un très, très beau film: envoutant, bien filmé, de la magie, c captivant. Je le répète: un beau film de samourai...
Esthétique de l'achèvement.
On achève bien les samouraïs, on achève bien le cinéma. Tout cela, ce n'est qu'une affaire d'exécution - d'éxécution capitale. Proposition princeps de "Goyokin", grand film nihiliste, c'est elle qui lui permet toutes les fantaisies, tous les écarts, tous les espaces : lorsque tout est perdu, il ne reste qu'à sauver la face. Cette face, chez Hideo Gosha, c'est celle de tous les maniérismes : avant-plan et arrière-plan, neige et vent, feu et glace, tous les basculements esthétiques deviennent possibles, parce que plus aucun d'entre eux ne compte. Indifférence. Cinéma décédé. Cinéma du vide. Il ne faut pas en attendre autre chose, ni chez Gosha, ni chez Fukasaku, ni chez Suzuki, ni nulle part dans le cinéma japonais. Car si ce cinéma a toujours été un cinéma de l'invention cinématographique, c'est parce que c'est aussi un cinéma qui a toujours fait fi du contenu. On ne raconte rien, dans "Goyokin", on manipule des formes, on compte de corps, on suit des mouvements. On ne démontre rien, on se contente de montrer. Montrer quoi ? Que toute cette agitation, n'est-ce pas, est un peu vaine. Que l'on s'en fiche. Alors autant faire joli. Pourquoi pas ?
Le grand silence
Une réalisation qui a trente ans d'avance, de superbes plans sur fond enneigé, l'océan comme frontière, et des interprètes, Nakadai en tête, hallucinants de justesse dans leur jeu.
Hideo Gosha est avec Fukasaku, Inagaki, Okamoto et Misumi l'un des immenses auteurs du chambara. Sa réalisation est d'une grande maîtrise, il installe les codes du genre dans un climat onirique à la limite du fantastique, se servant du paysage hivernal pour ajouter à l'ambiance une sorte de désespérante monotonie.
Son utilisation des tons qu'offre ces magnifiques payages hivernaux coule de source, le blanc accentue obligatoirement tout ce qui s'y pose, les corps, leur sang...
Contrairement à un Kenji Misumi ou à un Kinji Fukasaku, la violence chez Gosha n'est pas très graphique, il ne montre pas, ses combats ne sont pas particulièrement démonstratifs, ils sont par contre brusques et les coups sont portés avec justesse, la grande intensité qui se dégage de ces joutes découlent de l'observation comme dans les duels du western italien.
Tels sont les codes du chambara, des ronins solitaires qui s'opposent à une autorité, des combats lents et des coups portés brièvement, une ambiance quasi fantastique, et un esthétisme de pointe avec des paysages magnifiques.
Rajoutez à celà le grandiose et charismatique Tatsuya Nakadai en samourai repenti rédempteur, un personnage féminin qui installe le mélodrame, et tout un tas de figures du genre avec des tronches patibulaires, et des épéistes et vous obtenez un splendide film à l'esthétisme qui confine au beau.
petite déception aussi
ptet est-ce l'effet de la couleur ,un enchainement de film en noir et blanc et tada goyokin au milieu . je ne sais pas trop.
l'effet sword of doom visioné juste avant aussi ptet (il faut comprendre que SoD m'a beaucoup plu). je ne sais pas trop.
bon film cependant hein.
un bon chambara....
un bon chambara car c'est un film plutot original....tout en conservant les figures traditionnels du genre!
dans un décor glacé,GOSHA maitrise sa mise en scene remarquablement et imprime un vrai sens esthetique qui trouvera son aboutissement artistique avec le film "THE WOLVES"....
classique du cinema japonais
Chambara!!
Savez vous qu'il parait que ce film devait être le 5ième Yojimbo à l'origine? Mais Mifune aurait été découragé par le froid et la neige.
C'est donc Nakaai qui s'y colle.
Hideo Gosha, avant de devenir spécialiste du Yakuza Eiga, a débuté sa carrière en tant que spécialiste des films de samourai.
Que ce soit dans la chronique d'époque avec des saga comem Tenchu (Hitokiri)ou les chambara, Gosha à donné des classiques du Jida-Geki des années60.
Côté Chambara, Goyokin est parfait.
Le froid, la neige, tout participe à rendre les duels
glaçant (oui je sais c'est facile).
Débutant comme un film fantastique horrifiant,
le film devient petit à petit un chambara.
Nous suivont Nakadai qui tente d'empêcher son ami et beau-frère de commetre un massacre.
Le style Gosha est bien en place. La nature, la température, la lumière, le décors en fait, est un personnage part entière.
Souvenez vous The Wolves. Un Ninkyo avec le même Nakadai que Gosha tourna en 1971. Avant que l'on tombe dans les complots, les scènes d'honneurs, les meurtres aux couteaux et tout les éléments du Ninkyo, on assistait à des scènes contemplative situé dans une natures, digne de tableaux.
Même choses, les personnages sont au milieu de cette nature, leurs actions est influencé par cette nature. En témoigne ces combats dans la boue ou la neige.
Et comme dans plusieurs Gosha, la musique traditionelle et les divers festivaux qui marquent chaques saisons servent la narration. Sans révéler aucun évenements important du film, ceux qui ont vu, savent l'Efficacité d'une certaine scène entrecoupé de percussionniste s'agitant autour de leurs tambours (comme dans The Wolves en fait) ....
Un chambata typique de Gosha et typique de l'époque.
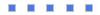





 Une trame historique intéressante, une atmosphère décrépie qui respire la fin des samourais et les grands westerns aux héros désenchantés (Le grand silence sans hésitation) mais un scénario tout de même trop simpliste et un seul véritable enjeu qui décuple la lenteur malgré la grandiose mise en scène de Gosha. Moins puissant que Sword of doom par exemple, dans sa dénonciation du système féodal. Déception même si le film reste un grand classique superbement maîtrisé, que tous les acteurs sont phénoménaux (la prostituée, incandescente) et Tatsuya Nakadai est impérial comme d'habitude.
Une trame historique intéressante, une atmosphère décrépie qui respire la fin des samourais et les grands westerns aux héros désenchantés (Le grand silence sans hésitation) mais un scénario tout de même trop simpliste et un seul véritable enjeu qui décuple la lenteur malgré la grandiose mise en scène de Gosha. Moins puissant que Sword of doom par exemple, dans sa dénonciation du système féodal. Déception même si le film reste un grand classique superbement maîtrisé, que tous les acteurs sont phénoménaux (la prostituée, incandescente) et Tatsuya Nakadai est impérial comme d'habitude.
 Avec Goyokin, Hideo Gosha signe une réussite majeure du cinéma de sabre des années 60, celui où les mercenaires ont remplacé les héros humanistes kurosawaiens. Mine de rien, les 2 heures du film passent sans que l'on s'en rende compte et l'on éprouve un plaisir identique à celui ressenti en regardant un Sergio Leone des débuts ce qui n'est pas la pire des références.
Avec Goyokin, Hideo Gosha signe une réussite majeure du cinéma de sabre des années 60, celui où les mercenaires ont remplacé les héros humanistes kurosawaiens. Mine de rien, les 2 heures du film passent sans que l'on s'en rende compte et l'on éprouve un plaisir identique à celui ressenti en regardant un Sergio Leone des débuts ce qui n'est pas la pire des références. Surtout, Goyokin regorge de superbes idées de mise en scène: l'ouverture où la caméra suit le mouvement des vagues, le générique à la photographie couleur or, les nombreux plans où l'on ne voit que le visage de Nakadai dans l'obscurité comme pour montrer qu'il se sent un fantôme dans ce monde (il dira d'ailleurs: "ils peuvent me tuer, je suis déjà mort le jour où j'ai laissé périr les pécheurs" comme s'il était déjà mort en tant que samourai), l'attention aux détails (gros plans sur les yeux, le trou dans un mur), l'utilisation de la neige, de la pluie, de l'obscurité et des incendies lors des magnifiques combats au sabre, les plans distants durant ces combats ou lors de certaines scènes de dialogue afin de créer le suspense sur leur issue, la combinaison de travellings hypnotiques et de zooms pour montrer un détail du décor, l'intrusion d'une scène typiquement western (la joueuse de dés traînée à terre à l'aide d'une corde tenue par un cavalier), l'exploitation réussie du cadre des rivages d'Hokkaido lors des scènes finales du film, l'alternance duel au sabre/plans sur les musiciens portant des masques traditionnels et jouant du tambour qui donne un rythme et une intensité accrus au duel final. La musique de Masaru Sato combine l'esprit de sa partition pour Yojimbo avec une superbe utilisation des cordes.
Surtout, Goyokin regorge de superbes idées de mise en scène: l'ouverture où la caméra suit le mouvement des vagues, le générique à la photographie couleur or, les nombreux plans où l'on ne voit que le visage de Nakadai dans l'obscurité comme pour montrer qu'il se sent un fantôme dans ce monde (il dira d'ailleurs: "ils peuvent me tuer, je suis déjà mort le jour où j'ai laissé périr les pécheurs" comme s'il était déjà mort en tant que samourai), l'attention aux détails (gros plans sur les yeux, le trou dans un mur), l'utilisation de la neige, de la pluie, de l'obscurité et des incendies lors des magnifiques combats au sabre, les plans distants durant ces combats ou lors de certaines scènes de dialogue afin de créer le suspense sur leur issue, la combinaison de travellings hypnotiques et de zooms pour montrer un détail du décor, l'intrusion d'une scène typiquement western (la joueuse de dés traînée à terre à l'aide d'une corde tenue par un cavalier), l'exploitation réussie du cadre des rivages d'Hokkaido lors des scènes finales du film, l'alternance duel au sabre/plans sur les musiciens portant des masques traditionnels et jouant du tambour qui donne un rythme et une intensité accrus au duel final. La musique de Masaru Sato combine l'esprit de sa partition pour Yojimbo avec une superbe utilisation des cordes.