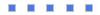Un manga qui tranche par rapport au reste... 

Un jeune dessinateur de talent, une galerie de personnages captivants, des samouraïs, des rônins, diverses écoles de sabres, du fantastique... Telles sont en substance les qualités « intrinsèques » du manga de Hireoki Samura. En tous les cas telles sont les qualités qui ont permis à ce que l’Habitant de l’Infini arrive aussi vite en occident, puisque depuis quelques années ce dernier est aussi bien publié en Europe qu’aux Etats-Unis alors que son auteur, à peine âgée de 30 ans, signe là sa première œuvre professionnelle... Voila ce qu’on appelle probablement un « talent précoce » car depuis 1994, année de la première publication de l’Habitant de l’Infini au Japon, la cote de Samura n’a cessée de monter, tout comme le nombre de ses fans. Beaucoup voit en lui, à juste titre, l’exemple même d’une nouvelle génération de mangaka qui, de Matsumoto à Nihei, apporte du sang neuf à une industrie qui... n’en manque pas vraiment. En réalité ce n’est pas tant sur le plan du volume des ventes, néanmoins respectables et en constante discrète progression, que ces œuvres font la différence mais dans leur impact artistique par rapport au tout venant de la production. D’où la considération plus « profonde » dont sont l’objet des ouvrages comme l’Habitant de l’Infini sur la scène internationale...

Pré publié depuis 1994 dans le magazine japonais Afternoon Comics et en volume (bunko) également (13 tomes à ce jour), l’Habitant de l’Infini marque d’entrée sa particularité en passant outre une série de codes bien établis pour les mangas de samouraïs (jidai-geki pour ceux à dimension historique et chambara pour les « serial »). Il ne les fait pas sien, ne les dépasse pas, non plus qu’il ne les nie. Il se contente de les contourner en brisant les soubassements narratifs qui président à leur utilisation : dans l’Habitant de l’Infini le bushido, le code de l’honneur des samouraï dans un sens restrictif, n’est plus un « fil à plomb » dont on s’écarte ou non (comme une limite morale chez nous, mais aussi sociale, politique...) mais une valeur tout simplement dépassée : soit par le mouvement de la « petite » histoire –la guerre que l’école de Itto-Ryu mène contre le système des écoles et du bushido en perte de vitesse dans cette période paix (1782/1783)- soit par celui d’une trajectoire personnelle, en l’occurrence la malédiction qui frappe Manji. Ceux qui comme la jeune Rin, en cherchant à venger la mort de ses parents, se comportent encore (ou essayent) en fonction du bushido, se voient face est des choix qui sont autant d’impasses...

Cette liberté vis-à-vis des (du) codes est la condition au déploiement d’imagination dont fait preuve l’auteur pour tout ce qui touche aux design des personnages ainsi qu’à celui des armes. En effet, conscient de ne pouvoir assumer une approche historique satisfaisante (à ses yeux mais surtout vis-à-vis des lecteurs) Samura introduit d’entrée les éléments scénaristiques lui permettant de s’en affranchir, ou plus précisément de s'émanciper de toute obligation de "préciosité" historique. Cela concerne avant tout des détails, comme des accoutrements et des coiffures de quelques personnages, car son aventure est tout de même historiquement située : Ainsi, en plus de « dramatiser » immédiatement le personnage de Manji par le mystère de l’élément fantastique que personnifie la fascinante, mystérieuse et vieille Yaobikuni (littéralement « la prêtresse de 800 ans »), Samura tire son récit sur des terres encore peu exploitées dans le genre sous un angle aussi mature : la quête de son héro n’est pas destinée, quel qu’en soit les raisons (vengeance, ambition, idéaux...), à accroître son potentiel « d’être dans son étant » comme pourrait le formuler un philosophe allemand de série, mais bien de mettre fin à ses jours... en l’occurence à son immortalité. Manji, qui porte son passé comme un fardeau, voit dans l’état d’immortalité un chemin de croix indéfini, c'est-à-dire une raison suffisante pour avoir le courage d’envisager pratiquement la seule sortie qui semble se présenter à ses yeux : le suicide. Car si le ver d’immortalité, le kessen-chu que lui a insidieusement donné Yaobikuni, lui permet de guérir de quasiment toutes ses blessures, une fois débarrassé de celui-ci et des ses effets, ses plaies et nombreuses mutilation deviendraient de nouveau « actives »...

Si le motif premier de Manji, à savoir la condition de tuer 1000 personnes pour en finir avec son immortalité, peut apparaître comme expiatoire (il paye ses 100 crimes précédents), c’est surtout la dimension de « fuite en avant » qui reste, celle de quelqu’un ne trouvant plus de porte de sortie à sa détresse. D’où le côté profondément cynique du personnage. Le cynisme comme protection, comme dénégation de sa propre douleur, à l’image de son ver d’immortalité. Parfait anti-héros, il n'est pas aussi fort qu'il en a l'air, perdant de sa technique au cours du temps et de ses successives "guérisons"... Le nihilisme de Manji rentre en résonance avec celui d’un Anotsu (le meneur de Itto Ryu) et de sa quête de destruction, tout comme avec celui de la plupart des autres protagonistes, véritable galerie de délaissés du système, de marginaux. Car Samura semble surtout s’intéresser aux figures de parias nihilistes, faisant de ses personnages des sortes de « punks » lâchés dans le monde des samouraïs. En ce sens « l’esprit » de l’Habitant de l’Infini est bien plus celui de notre époque, fondamentalement, que celui du Japon dans lequel se déroule le récit. D’où la présence d’une panoplie d’armes et de techniques de combat pas vraiment réalistes bien que « crédibles » pour le tout venant des lecteurs (on n’est pas dans un Kenshin). Ainsi Manji utilise t-il pas moins de douze armes différentes dans ses combats, les déployant seules où de façon combinées, allant même parfois jusqu’à les utiliser toutes en même temps ! L’occasion pour l’auteur de réaliser quelques pleines ou double pages qui tiennent souvent bien plus du travail d’illustration tant domine, dans la composition, le souci de la forme (motifs symboliques ou purement décoratifs, combinaison du dessin crayonné et à l'encre, poses "impossibles"...) au détriment d’une certaine lisibilité aussi parfois.

Mais nous ne sommes pas dans la même optique qu’un Lone Wolf and Cube dont les deux auteurs, scénariste comme dessinateur, possédaient une connaissance intime de la dimension martiale de leur récit en tant que pratiquant chevronnés de kendo. Ici c’est avant tout l’aspect « plastique » qui domine (bien que les combats ne soient pas en reste tout de même) et non une volonté « ciné(ma)tique » (quoique sur la longueur la mise en page tennd à se dynamiser un peu plus). De même le scénario, bien que distrayant, n'est pas encore à la hauteur du travail graphique. Sans être mauvais avec son point de départ intéressant, l'histoire manque encore d'un peu de substance sur la durée et les caractérisations psychologique sur certains personnages particulièrement fascinants peuvent laisser un léger sentiment de frustration. On sent que l'auteur, en pleine possession de ses moyens de dessinateur, manque encore d'expérience en tant que narrateur. Une faiblesse toute relative vu la qualité d'ensemble de ce manga. Dommage que l’édition française ne lui rende pas vraiment hommage par le choix d’un papier qui atténue la
force du dessin (voir les éditions japonaises et américaines chez Dark Horse pour s’en convaincre). Edition française qui semble aussi pêcher par des imprécisions pour ce qui concerne les dialogues (inversion de bulles ?). Mais cela reste tout de même une édition indispensable pour qui ne lis pas l’anglais ou le japonais, même si le rythme des sorties françaises compte tout de même 6 tomes de retard... Déjà un classique.
Ah oui, c'est parfois un "peu" sanglant.