Un film à part
Film après film, Tsai Ming-Liang affirme sa marque de fabrique, celle d’un auteur à la fois libre et cohérent dans son propos, qui ne fait aucune concession à qui que ce soit d’un point de vue formel ou narratif. Libre aussi au spectateur de faire l’effort de venir à lui, ou bien de s’en détourner furieusement, passablement énervé par la lenteur du film, par l’absence de dialogues, de musique et de scénario.
 Pour ma part, j’apprécie vraiment de découvrir le dernier film de Tsai. J’ai bien sûr du mal à m’emballer totalement pour une œuvre si volontairement hermétique et dont il nous manque bien des codes pour la déchiffrer complètement (le matelas est par exemple un clin d’œil à un scandale politique qui a affecté le 1er ministre malais il y a quelques années, fallait le savoir…), mais je me sens devant ses films un peu en famille tant j’ai plaisir à retrouver les aventures de Lee Kang-Sheng, un personnage complètement ahuri, hors du temps, passif et soumis, qui ne décroche jamais un mot mais qui fait fondre d’envie tous les personnages qui l’entourent et qui sont en quête de sens, de sentiments. Dans I don’t want to sleep alone, qui marque le retour de Tsai dans son pays natal, la Malaisie, c’est un travailleur immigré bengladeshi, une patronne de bar et l’inévitable Chen Shang-Chyi qui gravitent autour de Lee alors qu’il ne parvient pas à se remettre d’une agression qui l’a clouée au lit.
Pour ma part, j’apprécie vraiment de découvrir le dernier film de Tsai. J’ai bien sûr du mal à m’emballer totalement pour une œuvre si volontairement hermétique et dont il nous manque bien des codes pour la déchiffrer complètement (le matelas est par exemple un clin d’œil à un scandale politique qui a affecté le 1er ministre malais il y a quelques années, fallait le savoir…), mais je me sens devant ses films un peu en famille tant j’ai plaisir à retrouver les aventures de Lee Kang-Sheng, un personnage complètement ahuri, hors du temps, passif et soumis, qui ne décroche jamais un mot mais qui fait fondre d’envie tous les personnages qui l’entourent et qui sont en quête de sens, de sentiments. Dans I don’t want to sleep alone, qui marque le retour de Tsai dans son pays natal, la Malaisie, c’est un travailleur immigré bengladeshi, une patronne de bar et l’inévitable Chen Shang-Chyi qui gravitent autour de Lee alors qu’il ne parvient pas à se remettre d’une agression qui l’a clouée au lit.
D’une beauté formelle impressionnante, plongée dans un silence épais, l’œuvre de Tsai se vit comme un poème désenchanté sur les dommages collatéraux de l’expansion économique, comme un îlot de calme dans une vie trop speed, comme une recherche du bonheur à travers les choses simples de la vie, à commencer par la proximité humaine, la solidarité, le désir, thèmes magnifiés au travers d’un plan final saisissant où les 3 protagonistes dorment sur un matelas flottant sur l’eau. Définitivement auteur, définitivement hardcore dans ses choix artistiques, c’est un film qui ne laisse pas indifférent et auquel on repense souvent.
La prétention d'un cinéma, sans intérêt.
 Au risque de me faire lyncher par une partie de l'équipe, il n'y a pas à tortiller, IDWTSA est le genre de film monstrueusement pénible dont je pourrai me passer lors d'un festival. Pourtant, Tsai Ming-Liang, auteur du récent La Saveur de la pastèque s'était déjà forgé une réputation critique plutôt flatteuse, n'en déplaise à ses détracteurs. Dans un cadre à nouveau malade et d'une pauvreté consternante (certaines images sont difficiles), IDWTSA ne propose rien de plus qu'un quotidien (ou une parcelle de journée) filmé de manière "originale": record d'enchaînement de plans fixes d'une banalité confondante, recherche d'un style documentaire plat, filmage de discussions de bar, rien qui ne peut porter l'appellation de "cinéma". Tout est aléatoire, inintéressant, sauf si l'on apprécie de voir d'un oeil presque "voyeur" une bonne femme laver quotidiennement un légume, un type draguer une femme spécialisée dans les soins divers, ou un ouvrier s'occuper d'un sans-abri tabassé la veille et qui ne ressemble plus à rien.
Au risque de me faire lyncher par une partie de l'équipe, il n'y a pas à tortiller, IDWTSA est le genre de film monstrueusement pénible dont je pourrai me passer lors d'un festival. Pourtant, Tsai Ming-Liang, auteur du récent La Saveur de la pastèque s'était déjà forgé une réputation critique plutôt flatteuse, n'en déplaise à ses détracteurs. Dans un cadre à nouveau malade et d'une pauvreté consternante (certaines images sont difficiles), IDWTSA ne propose rien de plus qu'un quotidien (ou une parcelle de journée) filmé de manière "originale": record d'enchaînement de plans fixes d'une banalité confondante, recherche d'un style documentaire plat, filmage de discussions de bar, rien qui ne peut porter l'appellation de "cinéma". Tout est aléatoire, inintéressant, sauf si l'on apprécie de voir d'un oeil presque "voyeur" une bonne femme laver quotidiennement un légume, un type draguer une femme spécialisée dans les soins divers, ou un ouvrier s'occuper d'un sans-abri tabassé la veille et qui ne ressemble plus à rien.
Tsai Ming-Liang ou l'apothéose du contemplatif malsain et du propos sans intérêt. Certaines images sont acceptables, comme ce plan final où trois tourtereaux tapent une sieste bien méritée sur un matelas voguant sur l'eau, telle une feuille morte vers le néant. Le cinéaste de Et là-bas, quelle heure est-il? usurpe son étiquette de cinéaste culte. Mais quelle est même la définition de son IDWTSA? La manie hautaine de proposer du cinéma dit d'auteur avec un script tenant sur deux lignes? Des dialogues longuement et richement composés sur une page recto verso? La froideur et l'indifférence du traitement des personnages? L'enfer.
n'ais crainte, la salle dort avec toi 
L'année dernière j'ai pu voir mon premier film de
Tsai Ming-liang,
La saveur de la pastèque. Un film ma foi étonnant, bien loin de ce à quoi je m'attendais, avec du cul et des chansons, et d'après ce que je m'en souviens pas trop mal réalisé. Donc j'ai sauté sur ce
I don't want to sleep alone, tout frétillant de voir un nouveau film déjanté, et ce fut une nouvelle fois bien loin de ce à quoi je m'attendais. Mais si j'aime être surpris dans le bon sens, je digère mal de l'être dans le mauvais - surtout que dans le cas présent, c'est avec l'art et la manière, et pas avec le dos de la cuillère.
J'ai coutume de dire qu'on reconnait facilement un mauvais film quand durant la projection au milieu d'un torrent de nullité on se surprend à faire la remarque "awé, ce plan là il est chouette",
I don't want to sleep alone a bien failli ne même pas me réserver ce plaisir. Et encore, je me demande si c'est pas moi qui ai constemment baissé mon niveau d'exigence tout le long de la séance.
Tsai Ming-liang ne bougera donc jamais sa caméra (à part si j'ai dormi, mais ça serait traitre de sa part), mais après tout beaucoup la secouent pour rien dire, le plan fixe ça a parfois du bon. En fait il suffit que ça soit correctement monté. Mais
Tsai Ming-liang ne fait aucun effort de montage. Sérieusement, je les ai comptés, il n'y a que six scènes qui comportent de véritables points de montage - cad pas une coupure aléatoire entre deux séquences sans relation, mais un vrai effort de construire un espace dans le film. On dira qu'un plan séquence fixe est parfois sauvé par son cadrage et sa composition, mais encore une fois quasiment aucun effort de ce point de vue, je jurerais que c'est cadré par ma grand-mère. Je passe sur les autres éléments qui aurait pu limiter la casse (photographie, son,...) qui souffrent de la même négligence. Alors oui, film dans lequel tout point de vue, toute vision, est remarquablement absent,
I don't want to sleep alone est le degré zéro du cinéma, son réalisateur ne faisant même pas l'effort de vouloir utiliser la moindre once de langage cinématographique.
Pire que ça,
I don't want to sleep alone est la parfaite caricature du "film d'auteur asiatique" dans ce qu'il a de plus stéréotypé, de plus ridicule et de plus prétentieux. Quasiment muet, sans réelle histoire mais quand même ponctuée de son lot de scènes de fesse, lent, terriblement lent au point où on pourrait obtenir un film normal en le passant en vitesse x2. Ne parlons pas des personnages, bien évidemment totalement creux, totalement privés de psychologie et qu'on croirait tous sous prozac, dont les personnalités même pas esquissées ont bien du mal à justifier les comportements incohérents. Le réalisateur a du se dire que ça serait surement un truc qui "fait bien" sur lequel les festivaliers s'extasieront de peur de passer pour celui qui n'a pas compris le film. En passant, je souhaite le plus grand courrage et la plus belle imagination à qui voudra écrire une chronique positive de se film sans tomber dans les clichés usuels (cinéma du réel au plus près des corps, incapacité à exprimer l'amour, ancrage politique,...) de la critique de films d'auteur trop chiants mais qu'on est forcé d'aimer sinon on est pas cinéphile donc on ressort les conneries du dossier de presse en tissant une grille de lecture psychanalo-sociétale du film. Aller, je vous aide, dites un mot de ce film splendidement rythmé par les scènes où les personnages trimbalent leur matelas à travers la ville qui scandent comme une mélopée triste - vous pouvez même pousser le bouchon plus loin en tissant la métaphore de la passion du christ portant sa croix (c'est toujours très apprécié), le transport de matelas devenant, comme la flotte devient pinard, le Golgotha personnel des trois personnages. Trois personnages, trois croix, vous pouvez continuer sur la lancée de ce genre d'interprétations vides de sens, je vous laisse décider duquel des trois va jouer Jésus. Pour finir un petit mot de la profonde poésie mélancolique qui se dégage de ces scènes d'un chantier innondé ou encore de ville envahie par la fumée d'un incendie. L'eau et le feu, le déluge et la pluie de sauterelles, c'est le bonheur, l'interprétation biblique marche encore. Bullshit ! Ca marche toujours, en particulier quand on a rien à dire.
Alors voilà, jamais je pensais devoir mettre un zéro, pensant qu'après tout dans tout film on pourrait trouver un petit quelque chose, un embryon de construction, ne serait-ce qu'une tentative de batir quelque chose de cinématographique. Mais non - même pas.
I don't want to sleep alone, c'est le néant.
Témoin muet
Après le coup d'éclat de sa "Saveur de la pastèque", Tsai Ming-liang revient vers un cinéma plus posé, mais en aiguisant le côté charnel de ses interprètes. Lee Kang-sheng, véritable muse inspiratrice du réalisateur, traîne une nouvelle fois sa carcasse dans des images de toute beauté. Au-delà des sempiternels thèmes de l'incapacité de communiquer et de vivre pleinement l'amour, Tsai aborde également un problème plus politique, celui des ouvriers clandestins arrivés par milliers au sommet du boom économique et souvent devenus prisonniers du pays depuis sa récession. Véritables moutons noirs de la société malaisienne, Tsai les montre – au contraire – comme un société soudée et ouverte envers leur pays hôte. Apparemment personne d'autre n'aura jamais secouru le personnage de Lee autre que ces émigrés.
Au-delà de ce constat, le côté charnel est une nouvelle fois exploité à l'extrême dans des magnifiques plans d'une atmosphère unique. Là encore, le support transcende le simple média filmique pour se muer en un véritable (septième) Art – à défaut d'être réceptif à ce genre de choses. Un cinéma qui éveille des sens et propose une merveilleuse pause artistique récréative et bienvenue du stress du quotidien de tous les jours…
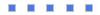

 Pour ma part, j’apprécie vraiment de découvrir le dernier film de Tsai. J’ai bien sûr du mal à m’emballer totalement pour une œuvre si volontairement hermétique et dont il nous manque bien des codes pour la déchiffrer complètement (le matelas est par exemple un clin d’œil à un scandale politique qui a affecté le 1er ministre malais il y a quelques années, fallait le savoir…), mais je me sens devant ses films un peu en famille tant j’ai plaisir à retrouver les aventures de Lee Kang-Sheng, un personnage complètement ahuri, hors du temps, passif et soumis, qui ne décroche jamais un mot mais qui fait fondre d’envie tous les personnages qui l’entourent et qui sont en quête de sens, de sentiments. Dans I don’t want to sleep alone, qui marque le retour de Tsai dans son pays natal, la Malaisie, c’est un travailleur immigré bengladeshi, une patronne de bar et l’inévitable Chen Shang-Chyi qui gravitent autour de Lee alors qu’il ne parvient pas à se remettre d’une agression qui l’a clouée au lit.
Pour ma part, j’apprécie vraiment de découvrir le dernier film de Tsai. J’ai bien sûr du mal à m’emballer totalement pour une œuvre si volontairement hermétique et dont il nous manque bien des codes pour la déchiffrer complètement (le matelas est par exemple un clin d’œil à un scandale politique qui a affecté le 1er ministre malais il y a quelques années, fallait le savoir…), mais je me sens devant ses films un peu en famille tant j’ai plaisir à retrouver les aventures de Lee Kang-Sheng, un personnage complètement ahuri, hors du temps, passif et soumis, qui ne décroche jamais un mot mais qui fait fondre d’envie tous les personnages qui l’entourent et qui sont en quête de sens, de sentiments. Dans I don’t want to sleep alone, qui marque le retour de Tsai dans son pays natal, la Malaisie, c’est un travailleur immigré bengladeshi, une patronne de bar et l’inévitable Chen Shang-Chyi qui gravitent autour de Lee alors qu’il ne parvient pas à se remettre d’une agression qui l’a clouée au lit. Au risque de me faire lyncher par une partie de l'équipe, il n'y a pas à tortiller, IDWTSA est le genre de film monstrueusement pénible dont je pourrai me passer lors d'un festival. Pourtant, Tsai Ming-Liang, auteur du récent La Saveur de la pastèque s'était déjà forgé une réputation critique plutôt flatteuse, n'en déplaise à ses détracteurs. Dans un cadre à nouveau malade et d'une pauvreté consternante (certaines images sont difficiles), IDWTSA ne propose rien de plus qu'un quotidien (ou une parcelle de journée) filmé de manière "originale": record d'enchaînement de plans fixes d'une banalité confondante, recherche d'un style documentaire plat, filmage de discussions de bar, rien qui ne peut porter l'appellation de "cinéma". Tout est aléatoire, inintéressant, sauf si l'on apprécie de voir d'un oeil presque "voyeur" une bonne femme laver quotidiennement un légume, un type draguer une femme spécialisée dans les soins divers, ou un ouvrier s'occuper d'un sans-abri tabassé la veille et qui ne ressemble plus à rien.
Au risque de me faire lyncher par une partie de l'équipe, il n'y a pas à tortiller, IDWTSA est le genre de film monstrueusement pénible dont je pourrai me passer lors d'un festival. Pourtant, Tsai Ming-Liang, auteur du récent La Saveur de la pastèque s'était déjà forgé une réputation critique plutôt flatteuse, n'en déplaise à ses détracteurs. Dans un cadre à nouveau malade et d'une pauvreté consternante (certaines images sont difficiles), IDWTSA ne propose rien de plus qu'un quotidien (ou une parcelle de journée) filmé de manière "originale": record d'enchaînement de plans fixes d'une banalité confondante, recherche d'un style documentaire plat, filmage de discussions de bar, rien qui ne peut porter l'appellation de "cinéma". Tout est aléatoire, inintéressant, sauf si l'on apprécie de voir d'un oeil presque "voyeur" une bonne femme laver quotidiennement un légume, un type draguer une femme spécialisée dans les soins divers, ou un ouvrier s'occuper d'un sans-abri tabassé la veille et qui ne ressemble plus à rien.


