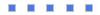

| Xavier Chanoine | 4  |
Tout Bong Joon-Ho, ou presque, est déjà là |
| Ordell Robbie | 2 | Conceptuellement fort. Mais le récit est otage de son concept. |

Avec Influenza, une grande partie du cinéma de Bong Joon-Ho est déjà là. Formidable film de dispositif exposant sur plus de quatre ans, et par le biais de caméras de surveillance, l’inexplicable dégénérescence d’un certain M. Cho et de sa partenaire, Influenza relève encore plus du simple exercice de style. A l’heure où le cinéma ne cesse de dévoiler de nouvelles perspectives grâce aux avancées technologiques, Bong Joon-Ho, à une époque (pas si lointaine) où la 3D n’était pas encore une obsession ou un outils à des fins purement commerciales, prend tout le monde à revers et réalise un véritable film de cinéma, passionnant dans son dispositif, sidérant par la sécheresse de sa violence et par son caractère déjà bien trempé. Il n’agit pas seulement qu’en tant que simple assembleur de séquences mises bout à bout les unes pour former un métrage respectant la demi-heure réglementaire du projet Jeonju Digital, il démontre avec simplicité que le cinéma n’est pas qu’affaire de travelings et de belle lumière ; par son sens de la durée et la violence permanente qui éclate à chaque nouveau plan-séquence (au sens propre, un plan = une séquence), Bong Joon-Ho réaffirme une certaine idée de cinéma sans en livrer toutes ses clés. Ici priment écriture et montage, au détriment du reste.
Il y a au départ les mauvais tours de M. Cho dans des toilettes publiques, personnage gentiment perturbateur et accessoirement illuminé, puis son arrestation par les forces de l’ordre sur un quai de métro. Déjà, au-delà même de son caractère perturbant et gentiment noir, le film est hilarant : on pense que le malfaiteur (présumé) va se faire raccompagner à la sortie du métro, mais le cinéaste nous prend une première fois à revers en pimentant la séquence, puis en lui offrant un caractère décalé par l’intermédiaire d’un personnage supplémentaire, celui d’une vieille dame curieuse vis-à-vis de ce que l’homme a laissé tomber au sol. La notion de durée des plans est aussi particulièrement maîtrisée, le cinéaste nous obligeant à regarder chaque cadre dans ses moindres recoins afin que, sans que l’on ne s’y attende, un détail vienne parasiter l’écran : un couteau de boucher laissé tombé, une vieille dame agressée après avoir retiré des sous. Cependant la violence excessivement réaliste, parfois à la limite du soutenable, est désamorcée par Bong Joon-Ho par un humour corrosif laissant échapper sa propre vision de la société coréenne. M. Cho et sa partenaire livrés à des excès de violence sans que l’on sache pourquoi, ces billets laissés à l’abandon par terre et tout de suite ramassés par un passant, ou un responsable de magasin qui, pendant son repas, n’en a que faire de cette pauvre dame tabassée et trainée au sol quelques mètres derrière. Bong Joon-Ho n’en oublie pas pour autant le détail qui tue : le responsable ne voit pas la scène mais en est conscient, son mouvement de tête indiquant clairement qu’il a pris l’information sans toutefois lui donner de l’importance. Son bol de nouilles instantanées est tellement plus important.
Au fur et à mesure que le métrage avance, poursuit avec de plus en plus de maîtrise cinématographique l’utilisation des caméras de surveillance, le cinéaste parvient à manipuler l’attention du spectateur en offrant aux séquences un double niveau de lecture, démultipliant les personnages à l’écran comme pour créer une confusion au sein même du cadre, en témoigne la grand-mère pillée de ses wons fraîchement retirés. Mais là-aussi, le caractère aberrant et lâche de la séquence laisse place au comique par la simple exécution d’une prise de judo, répétée avec soin. La séquence suivante transpire la terreur par son urgence et la sécheresse de sa violence : on y donne des coups de marteau, mais l’impact est aussi fort, voir même davantage que chez Park Chan-Wook. La raison ? Elle est incompréhensible car injustifiée (et respectant son contrat à la lettre, le cinéaste ne nous donnera pas d’autres informations que celles que nous voyons sous nos yeux), sans surenchère aucune ou théâtralisation. Cette violence est celle de tous les jours, elle n’est pas orchestrée par un bal de couleurs et de musique classique, elle est simplement filmée par des balayages latéraux réguliers, un nouveau dispositif bien utilisé par Bong Joon-Ho qui se sert des mouvements lents de l’objectif pour rendre le hors-champ encore plus effrayant, les montées de violence plus inattendues encore. Les deux prochains et derniers plans expriment à eux-seuls ce que le cinéma de genre coréen a de meilleur, à savoir une délicieuse variété de tons leur conférant des allures d’œuvres à part dans la stratosphère cinéma qui n’a pas finie d’être explorée : une visite à la banque aux allures de surprise-surprise et un épilogue en forme de feu d’artifice, de concentré de tout ce que Bong Joon-Ho a développé et développera au cours de sa jeune et passionnante carrière. Pourtant, en plein cœur de la zizanie, les deux malfaiteurs dégagent une sérénité à peine croyable, là aussi en total inadéquation avec ce qui se déroule sous nos yeux.
Influenza est à la fois un petit miracle perturbant et une géniale inspiration d’un cinéaste contredisant d’un plan à un autre, et parfois au sein d’un même, une ligne de conduite que l’on pensait toute établie. On pense alors à un seul mot d’ordre : surveillez-bien tout.


