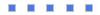Fleurs fanées
La douleur vous va si bien. Midori ou la poésie du grotesque érotico-trash à la Maruo Suehiro, courte œuvre artisanale de Harada Hiroshi qui en son temps fit couler pas mal d’encre au Japon. Censuré, détruit, le film fut néanmoins bien préparé face à l’adversité en continuant à être projetée en vidéo en cachette, à l’abri des regards indiscrets. Il faut dire qu’encore aujourd’hui Midori explore les tréfonds de l’être humain le plus infâme avec un jusqu’au-boutisme de forcené, pendant tout du moins sa première moitié. Sorte de petite vendeuse d’allumettes (remplacées ici par des camélias) orpheline de tout le monde (sa mère, malade, est clouée au lit, son père est décédé) qui se retrouve un beau jour –au bout de 2mn de film, en fait- accosté par un directeur de cirque lui promettant tout le confort qu’elle a toujours rêvé. Evidemment tout n’est qu’illusion puisque la petite va se retrouver prise dans les mailles de l’enfer : une galerie de freaks la viole pour lui dire bonjour avant qu’elle ne fasse partie intégrante du spectacle des enfers, réduite aussi à la bonne de service utile lorsque les moignons vivants ont envie de tirer leur coup. Que le spectacle commence.
Très vite le ton est donné. Les scènes ressemblent davantage à des toiles par moment animées, comme pour faire illusion et rappeler le travail de Maruo Suehiro, poète de l’ero-guro dérangeant dans sa représentation du sexe et de la mort. Le trait du dessin ne s’en éloigne d’ailleurs pas, au film d’être parcouru de visions qui, dans l’excès, atteignent parfois la poésie des vignettes de Maro Suehiro. Car avant d’être une succession d’humiliations crasseuses, Midori est le film sur le rêve désenchanté, l’épanouissement d’une jeune fille qui se fera à travers une série d’épreuves ignobles, sur sa condition de captive éprise de rêves de liberté symbolisés par le train qu’elle voit passer au loin et qu’elle ne prendra jamais. Dès le départ, Harada Hiroshi donne à son œuvre des airs de prison à ciel ouvert où la fuite, la liberté, ne se feront qu’à travers la mort de son héroïne ou de ses partenaires particuliers.
S’il adapte Maruo Suehiro de manière plutôt réussie, le film semble manquer de consistance. Tout est traité vite, sans doute trop, si bien que l’impression d’y voir un enchaînement de scénettes sans réel lien entre elles prend le dessus, la structure très linéaire du film (un nouveau chapitre, une nouvelle étape). Le film trouve heureusement un second souffle avec l’arrivée du personnage du nain dans la bouteille, offrant alors de nouvelles perspectives au métrage : les illusions s’enchaînent, le caractère de Midori s’endurcit, la violence physique et morale ne se distingue plus par son sens unilatéral. Le spectateur est transporté avec un minimum de moyens mais des idées de mise en scène géniales dans un tourbillon de visions et d’illusions cauchemardesques. On passe du grotesque et des flammes de l’enfer à un film d’amour et de vengeance parcouru de faux espoirs. Dans le genre nihiliste, Harada va très loin. S’y déploient des toiles marquantes en guise de bouquet final qui ne fait pas rire. Sans être un immanquable de l’animation nippone, Midori chuchote encore aujourd’hui à l’oreille du spectateur ses mélodies tristes et décharnées, dont son réalisateur semble prendre un malin plaisir à évoquer un monde tout aussi triste et dépourvu d’humanité.