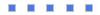

| Xavier Chanoine | 2.5 | Bon sujet, mais traitement pénible |
| Ordell Robbie | 3.5  |
On a déjà vu ça mille fois... |
| Yann K | 3.75 | Dérengeant et retenu |
 Avec un tel sujet casse-gueule, il eut été délicat de ne pas tomber dans la farce provocante et limite amorale compte tenu d'une thématique ouvrant de belles portes aux esprits tordus. Ici, rien de bien ragoûtant, le cinéaste posant son regard plutôt juste derrière la caméra sans rentrer dans la complaisance facile ou dans l'exploitation d'un thème déjà bien torché. Deux adolescents tombent amoureux, se dévoilent intimement et mettent en exergue des secrets jusque là enfouis dans le tiroir d'un bureau : photos fétichistes, enregistrement audio pervers, une découverte qui a le don de refroidir Satsuki. Et si le cinéaste traite son sujet avec le recul nécessaire, c'est parce qu'il met au grand jour de véritables sujets tabous avec un naturel confondant : toutes les pratiques douteuses de Takuya semblent ici filmées dans un ordre de pure logique, minutieuses à souhait. Et c'est justement le naturel confondant des séquences fétichistes qui instaure le malaise, tout comme la photographie terne et voilée voulue par le cinéaste, créant ainsi un tout, un univers sans grande logique ni ampleur. Le classicisme de la campagne, la forêt humide faisant ainsi perdre l'ensemble des repères des trois jeunes personnes, la chaleur des pièces où Satsuki s'envoie en l'air pour faire du mal, il n'y a pas un endroit qui ne respire la sérénité.
Avec un tel sujet casse-gueule, il eut été délicat de ne pas tomber dans la farce provocante et limite amorale compte tenu d'une thématique ouvrant de belles portes aux esprits tordus. Ici, rien de bien ragoûtant, le cinéaste posant son regard plutôt juste derrière la caméra sans rentrer dans la complaisance facile ou dans l'exploitation d'un thème déjà bien torché. Deux adolescents tombent amoureux, se dévoilent intimement et mettent en exergue des secrets jusque là enfouis dans le tiroir d'un bureau : photos fétichistes, enregistrement audio pervers, une découverte qui a le don de refroidir Satsuki. Et si le cinéaste traite son sujet avec le recul nécessaire, c'est parce qu'il met au grand jour de véritables sujets tabous avec un naturel confondant : toutes les pratiques douteuses de Takuya semblent ici filmées dans un ordre de pure logique, minutieuses à souhait. Et c'est justement le naturel confondant des séquences fétichistes qui instaure le malaise, tout comme la photographie terne et voilée voulue par le cinéaste, créant ainsi un tout, un univers sans grande logique ni ampleur. Le classicisme de la campagne, la forêt humide faisant ainsi perdre l'ensemble des repères des trois jeunes personnes, la chaleur des pièces où Satsuki s'envoie en l'air pour faire du mal, il n'y a pas un endroit qui ne respire la sérénité.  Mais cette chronique sur l'amour sadomasochiste trouve rapidement ses limites : alors que le personnage de Takuya semblait faire montre d'un grand charisme malsain en début de métrage, son nouveau rôle de chien finit par lasser et il en devient logiquement pathétique. Idem pour Satsuki, être frêle et mignon tombant dans la gratuité lâche et la violence primaire jusqu'à rendre son personnage halluciné, peut-être trop, pas bien cohérent (le final posant ainsi une grande incertitude sur l'avenir). Quant à Tadashi, il ne sait plus sur quel pied danser et ne sert que d'objet de haine pour humilier Takuya, à peine crédible lorsqu'il tente de raisonner les deux malheureux près de la cascade. Et cette crédibilité passe encore plus à la trappe lorsque après avoir sauté d'une cascade, Takuya se retrouve affublé de deux béquilles et d'un bandage sur la tête. Si sur le papier le film de Shiota Akihiko avait de quoi heurter par sa thématique pleine d'audace, on ressort avec la sensation de n'avoir assisté qu'à un honnête drame japonais, trop froid et mou pour marquer les esprits.
Mais cette chronique sur l'amour sadomasochiste trouve rapidement ses limites : alors que le personnage de Takuya semblait faire montre d'un grand charisme malsain en début de métrage, son nouveau rôle de chien finit par lasser et il en devient logiquement pathétique. Idem pour Satsuki, être frêle et mignon tombant dans la gratuité lâche et la violence primaire jusqu'à rendre son personnage halluciné, peut-être trop, pas bien cohérent (le final posant ainsi une grande incertitude sur l'avenir). Quant à Tadashi, il ne sait plus sur quel pied danser et ne sert que d'objet de haine pour humilier Takuya, à peine crédible lorsqu'il tente de raisonner les deux malheureux près de la cascade. Et cette crédibilité passe encore plus à la trappe lorsque après avoir sauté d'une cascade, Takuya se retrouve affublé de deux béquilles et d'un bandage sur la tête. Si sur le papier le film de Shiota Akihiko avait de quoi heurter par sa thématique pleine d'audace, on ressort avec la sensation de n'avoir assisté qu'à un honnête drame japonais, trop froid et mou pour marquer les esprits.


En particulier dans le cinéma japonais où les relations sado-masochistes sont un thème récurrent. De façon ultrastylisée (Oshima) ou avec une recherche complaisante de la scène-choc (Miike). Mais jamais avec cette dignité des cinéastes qui privilégient l'économie de moyens (comme un Tsai Ming Liang qui filmait une collectionneuse de conquetes d'un soir avec la meme caractéristique). Parce que ses personnages ont beau se masturber, renifler une chaussette, lécher les pieds de l'etre aimé, s'humilier, se faire subir les pires outrages, la caméra de Shiota Akihiko se tient toujours là en les cadrant au cordeau et créant remarquablement la durée, pleine de pudeur, consciente que ce n'est pas parce quelqu'un souhaite etre considéré comme un chien qu'on ne doit pas le filmer avec un minimum d'humanité. Et l'utilisation des voix off des personnages participe de ce désir de représentation en toute dignité. Shiota ne fait d'ailleurs ici que décrire un couple dans lequel le désir de domination finit par s'introduire dans la relation amoureuse et la transforme et nous offre un trio amoureux incandescent: le masochiste, la dominatrice et l'amant "normal". Ce trio donnera lieu à quelques situations d'une énorme force émotionnelle comme les moments où la jeune fille oblige son "esclave" à rester dans un placard et l'écouter en silence faire l'amour avec son copain ou encore le superbe final près des chutes d'eau où le trio s'explique et l'intensité dramatique retenue explose au milieu d'une ambiance sonore hypnotique. Ou encore lorsqu'elle l'oblige à espionner son premier rendez-vous avec son futur copain. Shiota Akihiko offre au travers de ce film un portrait au vitriol de l'adolescence japonaise comme lieu de cruauté et de rapports de force entre les etres. Et lorsque ces rapports de force explosent dans certaines scènes le malaise ressenti par le spectateur rappelle la violence brute que sont capables de saisir les meilleurs cinéastes naturalistes européens (les frères Dardenne, Pialat). Cette énergie sèche se retrouve d'ailleurs dans des scènes de kendo -c'est là que les désirs des personnages se matérialisent en premier- filmées avec un vrai souffle et un grand sens du rythme et du découpage.
Seul petit bémol: les dernières minutes qui tombent dans le piège voyeuriste évité précédemment. Mais pour le reste ce beau premier film révèle un jeune auteur japonais à suivre. Et après les réussites signées Harada et Hashiguchi il confirme la capacité des jeunes auteurs japonais à traiter avec retenue les sujets les plus sulfureux et risqués.
Une relation sado-maso dans le cinéma japonais, ça n’a rien d’original (voir l’Empire des sens, Tokyo Decadence, etc…) Mais chez des ados de 17 ans, c’est plus rare, et beaucoup plus iconoclaste. L’histoire de Moonlight Whipsers est étrange, puisque le personnage principal dit lui même être « malade » et que la fille, devenue la plus vicelarde des tortionnaires, est peut être pire car elle ne se rend pas compte de sa méchanceté. Dérangeant jusqu’au bout, le film a le mérite de ne jamais esquiver son sujet, tout en restant finalement très chaste (ce n’est pas un vrai catégorie III, même s’il est classé ainsi). C’est qu’il s’agit bien de jeunes ados, encore un peu dans la simplicité et la pudeur.
La mise en scène est souvent plus pudique que ses personnages. Elle reste parfois à distance, souvent pour exprimer, par un espace trop grand, le vide dans la tête du personnage principal. Le défaut du film est d’être trop appliqué, trop théorique. Shiota Akihiko veut tellement maîtriser son film que parfois il le fige avec une mise en scène trop démonstrative. Mais dans cette quête d’exigence, Shiota Akihiko invente des plans magnifiques, comme ce champ-contre-champ sous la pluie, à travers des vitres, complètement flou, sur Takuya et Statsuki, ou ce moment terrifiant : Takuya est dans un placard noir, avec seulement un rai de lumière qui perce. A « l’extérieur », dans la chambre, c’est l’horreur, Satsuki fait l’amour avec Tadashi. Takuya a le son, ce rai de lumière, ses souvenirs et son imagination, autant dire tout pour se faire son cinéma. Le plan dure, parce qu’il est magnifique.
Rien que pour ces quelques moments ou pour son casting parfait, Moonlight Whispers est à voir. En regardant Insectes Nuisibles, le cinquième film d’ Shiota Akihiko, on comprend en plus que dans ce deuxième film il posait les jalons d’une déjà « œuvre », déjà passionnante, centrée sur l’esprit malade des jeunes japonais.


