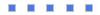

| drélium | 2 | |
| Ordell Robbie | 1.5 | Délaisse la bonne rétromania de Drive pour renouer avec la pose auteurisante. |
| Arno Ching-wan | 3.75  |
Notre Père qui êtes au cieux, restez-y (Jacques Prévert) |


... ou quand LaMotta a un sérieux problème avec La Mater.
« J'avais envie de détruire quelque chose de beau » avouait un personnage torturé dans le culte Fight Club de David Fincher. C'est en substance ce qu'a dû penser le réalisateur danois Nicolas Winding Refn en s'en allant détruire son icône de Drive, Ryan Gosling, avec ce radical Only God Forgives (OGF). En partie incomprise, l'icône, puisque psychologiquement le réalisateur du fabuleux Bronson l'avait déjà brisée en en faisant, in fine, davantage un repoussant tueur fou psychopathe qu'un énième Mad Max empathique. Appuyons là où ça fait mal, quitte à ne pas caresser les fans dans le sens du poil puisque notre gigolisé préféré du moment en prend cette fois plein la tronche. Enfance toxique, présent nauséeux, avenir souffrir... Mieux vaut mourir !
Il me plut de voir la fin de Valhalla Rising comme un au-revoir consommé entre Refn et son avatar précédent, incarné par Madds Mikkelsen. Cette fin vide de sens, qui figure aussi la page blanche, me fit penser que l'inspiration ne venait plus à un Refn adepte de l'improvisation. Sa muse ne l'habitait plus. A ses pas de viking de s'estomper, de disparaître dans cet usuel endroit fantasmé qu'est l'Amérique. A un autochtone d'y prendre le relais. A travers Gosling, Refn se venge-t-il de tant et tant de choses difficiles à exprimer ? Toujours est-il que cette variante du personnage Tonny dans les Pusher 1 et surtout 2 encaisse plus encore dans une belle continuité rouge sang. Fut un temps, NWR avouait volontiers qu'il aurait pu raconter ce qu'il voulait dans un film en l'appelant Pusher 4, 5 etc si cela l'aidait à mieux vendre un projet. En l’occurrence, avec cette famille de dealers expatriée à Bangkok, on l'a, notre Pusher 4.

Qu'est-ce qu'avoir des couilles en ce bas monde ?...
Et on le tient, le nouveau bijou du maître. Il réussit en Thaïlande avec son film citoyen du monde - production franco-suédo-ricaine, réalisateur danois, acteur américain... - comme John Woo marqua son territoire aux USA avec Volte-Face. Drive, un bon film, relevait de la série B un peu auteurisée sur les bords. Avec OGF, Refn se débarrasse de toute forme de cahier des charges. Il écrit le scénario. Adepte confirmé du cinéma de genre asiatique – voir et revoir Bleeder, son True Romance à lui, pour s'en convaincre -, il se laisse imprégner par ce pays, la Thaïlande, absorbe beaucoup de ses effluves avant de nous larguer à la tronche son poème guerrier qui s'en irait, en vain, prôner la paix. La route est longue, très longue ; la vie n'est qu'un combat sans fin que l'on se mène à soi-même, à travers les autres, à travers Dieu. Les Dieux. Voici l'apocalypse ! Qui trouve à sa source les champs de l'emprise et le maelström chaotique du monde ! Des vérités s'affrontent, l'absurde effraie et le méchant... n'en est pas un. Au contraire, petit à petit, Chang, le policier thaïlandais plus ou moins à la retraite incarné avec force par l'acteur Vithaya Pansringarm, dans la vie directeur d'une école de danse et expert en Kendo, évoque autant le colonel Kurtz d'Apocalypse Now qu'un Roi Salomon local. Pour faire régner la justice, il use d'une atroce violence, malgré lui et orientée, pour éviter un déluge plus horrible et plus injuste encore. Fascinant, son personnage, véritable héros du film, conçoit sa propre damnation en même temps que l'on perçoit des esprits environnants qui iraient dans son sens, l'aideraient dans cette tâche ardue. Il n'est pas seul, soutenu par ses amis et des forces d'outre-tombe comme un Frodon le serait par la Communauté de l'anneau. Voilà pour le point de vue. Adepte du manichéisme, une série B américaine lambda nous aurait présenté ce personnage comme un affreux mafieux sanguinaire de plus. Refn, non. Afin de porter son terrible fardeau, contrebalancer les horreurs qu'il commet et chercher cet équilibre qui lui permet vaille que vaille de continuer à avancer, notre policier, notre Dieu qui pardonne rarement, chante. Des choses naïves, simples, belles. Debout, sur scène. On replonge alors avec délice dans cette naïveté du ciné de genre de Hong-Kong des années 90. Les chansons sucrées de Sally Yeh qui apaisent la violence dans The Killer, celles des poètes au milieu des affrontements dans Swordsman et sa suite... Le contraste est saisissant dès lors que c'est à celui qui verse le sang d'aller chercher cette voix au plus profond de lui-même. Elle invoque des esprits à la présence devinée, comme on le fait nous à travers nos personnages de fiction préférés, des fantômes créés de toute pièce par des artistes inspirés.

La déesse égypto-grecque Baghee-Râ, reine panthère qui souhaite rester tandis que Léo part.
L’œuvre commence par un crescendo bien glauque, poisseux. La fin du premier chapitre imagé trouve son point culminant avec un déluge de violence gorissime fait de bras coupés, d'un visage massacré filmé en gros plan. Puis la nouvelle du décès de son frère est perçue par Julian (Gosling) avant qu'on ne la lui annonce. Refn reprend des éléments de la scène d'impuissance de Pusher 2 pour figurer l'absence d'un membre... de sa famille. Son frère, son bras droit tranché, s'en est allé. Avant le « toc-toc » à sa porte, on sait qu'il sait. Et l'on sait que Refn connaît The Blade et ses prédécesseurs sur le bout des doigts qui lui restent ! Le frère en question ? Désincarné par l'épatant Tom Burke, en quelques scénettes chargées de souffre le voici aussi mort que défini post-mortem comme l'odieux monstre de perversité qu'il était. D'aucuns n'arrivent pas à nous faire ressentir un personnage pareil sur un film entier ! Et tout ceci n'est que le début. S'ensuivent des scènes cultes sans temps mort et... comment ça, trop lent ? Groggy, Julian encaisse d'abord la perte de son frangin comme s'il s'était pris un coup de genou de boxe thaï dans la tronche. Il avance lentement, il titube, ne sait pas où aller. L'étirement du temps est pleinement justifié. On devine quand même Julian instable, blindé de démons, jusqu'à ce que l'arrivée de sa mère ne vienne confirmer l'ampleur du désastre psychologique. Cette véritable horreur prend vie – c'est un bien grand mot - à travers le jeu impressionnant de Kristin Scott Thomas ; et à son personnage de débarquer directement dans le top 10 des salopes les plus abjectes du cinéma. « Crystal », qu'elle s'appelle, la lionne. Crystal clear ? Ironique ! Boueuse, marécageuse, puante ! Infecte déesse grecque venue semer le désordre en ce monde qui n'en mérite pas tant. Julian, paumé, peine à s'extraire de cette cellule familiale vérolée. Il ne souhaite en rien se venger de son odieux frère. Toujours filmé dans un entre-deux, il fait davantage parler son corps que... Là où Refn fait du Lynch, ça n'est pas tant dans la forme que dans ce concept qui consiste à vouloir créer un sentiment, une émotion, davantage qu'une démonstration classique. Et à la forme de servir le propos. La photo à se damner de Larry Smith (un habitué de Stanley Kubrick), la musique, débarrassée des chansons pops de Drive, de Cliff Martinez (Kafka), les sons formidablement bien travaillés de Kristian Eidnes Andersen (un cador, apprécié par chez Lars Von Trier, Susanne Bier etc) et tous les oripeaux, non cités ici, vont dans le même sens. L'on ressent avant de chercher à comprendre. La haine, d'abord. Incompréhensible. Puis l'état cotonneux, distant, de cet étranger de Julian, pas si loin de celui d'Albert Camus, dont on fête cette année les 100 ans de sa naissance, lorsqu'il s'en va trouver une violence qu'il ne veut pas vraiment ; lorsqu'il se force à jouer à un jeu auquel il n'aspire pas. L'étranger tout simple, aussi, l'expatrié qui ne se sent pas à sa place dans un pays qui n'est pas le sien, ce qui fait écho à cet américain perdu en Corée du sud dans la très belle Adresse inconnue du coréen Kim Ki-duk. Pour fuir son triste destin, Julian devrait fuir à la fois sa famille et cette contrée. Facile ?

C'est lui ! C'est Blade ! Et sa fameuse technique thaïlandaise ancestrale pour bien se gratter le dos.
Puis vient notre héros, le fier, sévère et pervers cerbère ! Le paisible d'apparence Chang, qui lui n'est pas plombé par la lenteur de la perdition mais soutenu par celle de l'assurance. Le temps joue en sa faveur, ses ancêtres l'accompagnent, eux qui sont déjà morts depuis si longtemps. Il nous charme le temps d'une scène à la Ghost Dog, Martinez remplaçant joliment RZA sur un entraînement au sabre aussi planant que galvanisant. Puis on ne le lâche plus, l'empathie devient plus prononcée à son égard. A ce Dieu d'affronter la noire déesse, de mater la mater le temps de joutes orchestrées par un montage somptueux, notamment via ce fracassant champ-contrechamp à distance. Ils s'affrontent du regard par magie interposée, elle tout là-haut dans sa tour, lui tout en bas, dans sa ville. Doté d'une ambivalence toute kitanienne, notre héros maudit impose le respect tout autant que la pitié. Il encaisse lui aussi, et même s'il reste debout à chanter pour accompagner le générique de fin, on sait qu'il est mort, lui aussi. Se prendre pour Dieu a un prix. Le film touche à la perfection de l'épure et simple.


