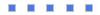

| Ordell Robbie | 1.5  |
Petite Lessive |
| Xavier Chanoine | 2.5 | Radical |

 Après un Pistol Opera en forme de synthèse de ses deux parties de carrière, Suzuki Seijun revisite les Tanuki Goten, série de comédies musicales qui eurent un grand succès au Japon entre 1939 et les années 50. Mais cette relecture aboutit à son film le plus faiblard depuis Histoire de mélancolie et de tristesse. En cherchant à dynamiter la comédie musicale à coup de choix "décalés", Suzuki enchaîne le plus souvent les idées dignes du premier cinéaste mode venu. Navrants et musicalement nuls ces passages chantés usant du rap, du flamenco, des slows mielleux (un pastiche de Queen entre autres...) et des comptines pour enfants en forme de décalé pour le décalé aussi léger qu'un tank. Navrants ces gags faisant dans l'humour lourd et qui donnent un sens péjoratif à l'expression "ne pas se prendre au sérieux". Navrants ces musiciens qu'on croirait débarqués du clip de Butterfly Ball, navrant ce passage dansé final qui fait réévaluer à la hausse la fin du Zatoichi kitanien. Malgré un sens de la composition et du cadre nous rappelant qu'on regarde un film de Suzuki, la grâce est ici aux abonnés absents. De la comédie musicale, il y en avait bien plus dans Tokyo Drifter ou Détective Bureau 2-3 qu'ici.
Après un Pistol Opera en forme de synthèse de ses deux parties de carrière, Suzuki Seijun revisite les Tanuki Goten, série de comédies musicales qui eurent un grand succès au Japon entre 1939 et les années 50. Mais cette relecture aboutit à son film le plus faiblard depuis Histoire de mélancolie et de tristesse. En cherchant à dynamiter la comédie musicale à coup de choix "décalés", Suzuki enchaîne le plus souvent les idées dignes du premier cinéaste mode venu. Navrants et musicalement nuls ces passages chantés usant du rap, du flamenco, des slows mielleux (un pastiche de Queen entre autres...) et des comptines pour enfants en forme de décalé pour le décalé aussi léger qu'un tank. Navrants ces gags faisant dans l'humour lourd et qui donnent un sens péjoratif à l'expression "ne pas se prendre au sérieux". Navrants ces musiciens qu'on croirait débarqués du clip de Butterfly Ball, navrant ce passage dansé final qui fait réévaluer à la hausse la fin du Zatoichi kitanien. Malgré un sens de la composition et du cadre nous rappelant qu'on regarde un film de Suzuki, la grâce est ici aux abonnés absents. De la comédie musicale, il y en avait bien plus dans Tokyo Drifter ou Détective Bureau 2-3 qu'ici.
On connaissait le Suzuki Seijun de la période Nikkatsu, enchaînant les sommets du polar pop avec une virtuosité qui fit sa force et sa renommée dans l'industrie cinématographique nippone, avant de connaître un sort plutôt funeste : un peu comme si l'on vire un responsable de boutique parce qu'il fait trop de chiffre. Il y a eu ensuite le Suzuki plus ancré dans une veine dramatique et expressionniste poussant la théâtralité encore plus loin que durant les sixties. Puis deux oeuvres de fin de vie, deux débuts de testament financés avec les moyens du bord où le cinéaste pousse l'expérimentation du cadre (qu'on le veuille ou non, plus forte que dans ses oeuvres passées) tellement loin que le résultat débouche sur deux sentiments diamétralement opposés : un sentiment d'incompréhension totale devant ce qu'on appelle un véritable bordel, et la joie d'avoir passé à chaque fois deux heures devant deux oeuvres déjantées sur le plan formel, osées mais aussi contents d'avoir été bousculés voir pris pour des cons tellement Suzuki se fiche des conventions. Un peu comme Godard période vidéo mais sans le néant cinématographique qu'on lui connaît. D'où l'appréhension de chaque oeuvre de Suzuki, l'appréhension de se demander ce qui va nous tomber sur la tête depuis la renaissance post La Marque du Tueur. L'appréhension de se ronger les ongles au moindre écart de conduite voulu, impertinent et conscient. Princess Raccoon appartient une nouvelle fois à cette catégorie de films anarchistes, complètement je-m'en-foutistes, fleuretant très souvent avec le zéro pointé mais qui ne vivent que parce que l'ombre de leur auteur plane sur chaque plan : une direction artistique de folie renvoyant aux "essais" tellement concluants d'un Tokyo drifter et à l'approche surréaliste du néo-théâtre pop entrevu dans Pistol Opera, mauvais film mais renversant d'expérimentation formelle plein cadre. C'est bien simple, Princess Raccoon n'est pas un polar, il n'est pas un jidaigeki, il n'est rien de bien connu. A mi-chemin entre la niaiserie des Walt Disney, la musicalité et l'esprit vainement fantastique des films de Miyazaki en mode contrefaçon, le théâtre traditionnel et le mélodrame fantastique digne d'un mauvais drama, le film de Suzuki est un improbable mélange des genres dont la vocation reste encore assez trouble : pousser le cinéma vers le radical sous peine de perdre une grande partie de ses fans? Simple attraction visuelle et thématique? Adieu et pied de nez à une industrie qui lui a gentiment fermé les portes lors de son apogée? N'est-ce pas là aussi la force des plus grands, qui est celle de bousculer systématiquement la donne, les conventions établies devenues tellement chiantes avec le temps? Si Princess Raccoon bouscule ces conventions, un arrière-goût vient entacher un plat qu'on n'attendait pas réellement. Cette sensation effectivement d'être en face d'un produit qui n'a d'intérêt que pour l'audace de son traitement, le scénario étant si insipide qu'il serait inutile d'en parler plus longuement ici même. L'oeuvre est donc incomplète, branlante à plus d'un titre, elle enchaîne les instants de mièvrerie avec un plaisir presque masochiste : où est donc passé le Suzuki période pop?


Ce Suzuki là semble débarquer de chez Disney avec quelques bouquins de théâtre en poche, histoire de ne pas perdre complètement le nord dans son entreprise de renouveler régulièrement ses travaux : tourné intégralement en studio hormis une séquence au bord de la mer, le film est enfermé dans une boule hermétique, prisonnière du monde qui l'entoure. Mais quel monde? Un monde créé de toute pièce par un directeur artistique inspiré, rendu vivant par la beauté de ses lumières et ses décors dessinés ou épurés à l'extrême. Seuls quelques faux backgrounds numériques viennent casser l'ambiance surréaliste où le théâtre navigue avec le dessin animé dans un esprit de liberté artistique aussi gerbant qu'audacieux : pas de juste milieu à l'horizon, juste les traces d'une hystérie palpable aussi bien sur le plan formel que musical où les très nombreuses chansons en japonais et en mandarin rythment le film. Tous poussent la chansonnette, Odagiri Joe chante faux (il n'est pas le seul, Depp l'a démontré avec le dernier Tim Burton), Zhang Ziyi fait dans la kawai-attitude, Yakushimaru Hiroko a encore de la voix (rappelons qu'elle était l'une des premières vraies "idoles" pop) et le Tokyo Ska Paradise assure un minimum de spectacle Club Med. Les fans apprécieront. En revanche, passons sur le raté total de l'unique chanson typée rap et sur le mauvais copycat de Misora Hibari (dont le cultissime Kawa no nagare no you ni avait été élu plus grande chanson japonaise de tous les temps) pour trouver au final un cocktail musical hétéroclite mais tenant la route. Ca tient la route, tout simplement, à l'image du film. Prendre le spectateur autant pour un imbécile relève d'une parfaite insolence de la part de Suzuki. Quelle idée a traversé l'esprit du cinéaste pour pondre sans doute l'une de ses oeuvres les plus radicales (elle devait être belle la projection du film en 2004 à Cannes, hors compétition!), quasi nonsensique, à la limite du ridicule? Le plan final de Zhang Ziyi et son masque de raton est d'un ridicule tellement immense que l'on croit durant une fraction de seconde au cauchemar. Ou au rêve? On s'embrouille là. Pari gagné pour Suzuki? Déjouer les attentes du spectateur, faire tourner en bourrique son esprit fatigué par autant de couleur, de zooms particulièrement bancals, de chansons à la limite de nous faire signer pour un rendez-vous annuel chez le psychologue. Suzuki est sans doute l'un des derniers grands dingues du cinéma japonais, et le plus inquiétant, c'est que Kitano est lui aussi tombé dans cette manie de, quitte à bouleverser ses habitudes, faire du cinéma nonsensique, décalé jusqu'à donner la nausée. C'est pas si mal, mais il est une nouvelle fois difficile de garder son calme devant un film au potentiel certain, plombé par une vraie vocation de faire du niais pour déstabiliser les moins courageux.




Quelques mots de Suzuki:
Je suis toujours heureux quand je peux réaliser un film comme on ferait un devoir de vacances. Mais ce film fut plutôt un concours d'entrée qu'un petit devoir à faire chez soi. Un des premiers problèmes de ce concours, c'était de pouvoir recruter l'actrice internationale Zhang Ziyi. Le second problème fut l'utilisation des images de synthèse, technique anti-cinématographique par excellence. Mais ce n'est pas à un vieux singe comme moi qu'on apprend à faire la grimace. J'ai répondu à toutes les questions qui étaient proposées à ce concours sans montrer le moindre affolement. Mon résultat est : disons 65 points sur 100. Etre dépendant des images de synthèse, je trouve que c'est une forme de paresse. ©Propos recueillis par Fabrice Arduini.



