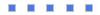ma note
-/5
Merci de vous logguer pour voir votre note, l'ajouter ou la modifier!
moyenne
3.64/5
Printemps Précoce
les avis de Cinemasie
3 critiques: 4/5
vos avis
11 critiques: 3.95/5
D’une clairvoyance étonnante
Printemps précoce est un film d’une grande modernité malgré ses 55 ans d’âge ; on peut en effet tout à fait se reconnaître parmi ces salarymen japonais qui prennent le train chaque matin pour se rendre au bureau, et constater que les soucis qui les animent (histoires de cœur, rancoeurs sur les stagnations de salaire, mutations, peur de la précarité,…) ne sont pas si éloignés de ceux d’un Caméra Café. Porté par un magnifique personnage masculin (Ikebe Ryo) qui parle par courtes phrases tout en intériorisant au maximum ses émotions – une sorte de Clint Eastwood avant l’heure, et par 2 personnages féminins dont le caractère est aux antipodes (Kishi Keiko, fraîche et insouciante, face à une Awashima Chikage posée et fataliste), l’œuvre d’Ozu surprendra par sa grande lucidité sur le sens de la vie, ainsi que sur un règlement des conflits basé sur la repentance et le pardon, mais sans grandiloquence aucune. Encore une fois, la zénitude de cet auteur et son style si particulier à narrer ses histoires font un bien fou.
Always coming back to you
 A partir d'un pitch vieux comme le cinéma -un homme trompe sa femme, ils se disputent avant de finalement recoller peu à peu les morceaux-, Ozu offre avec Printemps Précoce un beau film qui n'a rien à envier à ceux de sa période couleur. Un peu comme pour le Crépuscule à Tokyo de l'année suivante, la maitrise formelle de cet Ozu-là n'a rien à envier à celle de cette période qui s'ouvrira deux ans plus tard: meme si deux ou trois plans sont légèrement trop longs, si quelques cadrages n'ont pas la précision millimétrée que la cadre a la plupart du temps dans le film, la Ozu's touch y est ici exécutée avec une remarquable fluidité, un naturel qui la rend d'autant plus puissante parce que sa maitrise n'est pas visible. A noter malgré tout quelques travellings en forme de restes de l'époque où le cinéma d'Ozu avait les grands maitres américains dans le rétroviseur. Le tout donnant une belle réussite de l'age d'or fifties du cinéma japonais. Mais s'il appartient chronologiquement à cet age d'or le film y appartient-il véritablement artistiquement? A mon sens pas vraiment, on pourrait meme dire que dans son approche il annonce les Nouvellles Vagues. Tout simplement parce que Nouvelle Vague avant l'heure, Ozu l'était déjà dans sa période muette lorsqu'il ouvrait des pistes artistiques qu'on retrouvera par la suite dans le Néoréalisme et le cinéma d'auteur des années 60. Contrairement à une grande partie du cinéma de studio nippon de l'époque (Naruse, Masumura et Kawashima sont d'autres exceptions), il ne décrit pas des figures héroisées (là où les Kurosawa sous-influence néoréaliste en comportent encore) mais des personnages ancrés dans la réalité japonaise de son temps.
A partir d'un pitch vieux comme le cinéma -un homme trompe sa femme, ils se disputent avant de finalement recoller peu à peu les morceaux-, Ozu offre avec Printemps Précoce un beau film qui n'a rien à envier à ceux de sa période couleur. Un peu comme pour le Crépuscule à Tokyo de l'année suivante, la maitrise formelle de cet Ozu-là n'a rien à envier à celle de cette période qui s'ouvrira deux ans plus tard: meme si deux ou trois plans sont légèrement trop longs, si quelques cadrages n'ont pas la précision millimétrée que la cadre a la plupart du temps dans le film, la Ozu's touch y est ici exécutée avec une remarquable fluidité, un naturel qui la rend d'autant plus puissante parce que sa maitrise n'est pas visible. A noter malgré tout quelques travellings en forme de restes de l'époque où le cinéma d'Ozu avait les grands maitres américains dans le rétroviseur. Le tout donnant une belle réussite de l'age d'or fifties du cinéma japonais. Mais s'il appartient chronologiquement à cet age d'or le film y appartient-il véritablement artistiquement? A mon sens pas vraiment, on pourrait meme dire que dans son approche il annonce les Nouvellles Vagues. Tout simplement parce que Nouvelle Vague avant l'heure, Ozu l'était déjà dans sa période muette lorsqu'il ouvrait des pistes artistiques qu'on retrouvera par la suite dans le Néoréalisme et le cinéma d'auteur des années 60. Contrairement à une grande partie du cinéma de studio nippon de l'époque (Naruse, Masumura et Kawashima sont d'autres exceptions), il ne décrit pas des figures héroisées (là où les Kurosawa sous-influence néoréaliste en comportent encore) mais des personnages ancrés dans la réalité japonaise de son temps.
Meme si ce thème-là traverse toute son oeuvre sur la fin, cet Ozu-là développe d'ailleurs vraiment la description quasi-naturaliste de la condition du salaryman nippon. Les plans des salariés en chemin vers la gare, les plans de bureaux, ceux de salariés contemplant de la fenetre la ruée des cadres vers les bureaux tout cela suffit à dire le miracle économique japonais et un pays qui relève la tete. Sauf que meme si c'est avec un vitriol moins visible que les cinéastes japonais des années 60 Ozu dit aussi l'envers de ce miracle économique au travers des saouleries de salarymen, de l'envie suscitée chez les collègues par la liaison adultérine du film parce que quelque part ils ne trouvent que ça pour échapper à la monotonie du travail salarié, de quelques dialogues montrant que la plupart des personnages n'ont pas une très haute opinion de la condition de salarié. Le film évoque d'ailleurs la délocalisation provisoire et forcée de son personnage de salaryman adultérin. Le regard d'Ozu sur le couple est tout aussi critique: SPOILER désillusions de la vie de couple, ennui et routine poussant à l'adultère, découverte de celle-çi avec la tristesse et les déceptions qui lui sont liées, volonté de mettre un terme à une liaison brève mais libératrice avec les regrets et les malentendus que cela peut générer chez l'ex-maitresse, volonté de repartir à zéro malgré tout en mettant de coté les blessures d'amour propre décrite dans un émouvant final.
En humaniste, Ozu conclut sur l'acceptation des choses et la volonté de maintenir la cellule familiale malgré les éléments extérieurs -adultère, changements économiques- pouvant lui nuire tout en ne changeant rien au constat développé plus deux heures durant: la lucidité sur l'envers des choses, meme si elle implique des désillusions, n'empeche pas ses personnages d'aller de l'avant. FIN SPOILER
La fin d'un cinéma, les prémices d'un autre
Il est étonnant de voir à quel point Ozu perd sa manie de faire du cinéma sous influence au fur et à mesure que le temps passe et que sa filmographie s'élargit. Si ces années muettes respirent clairement l'influence occidentale avec moult clins d'oeil au cinéma de Buster Keaton ou de Lubitsch, les années 40 et 50 démontrent une toute autre facette du cinéaste : pas de procédés narratifs, pas de mains tendues au spectateur ni même d'intrigue à proprement parlée, tout n'est que chronique sur le temps qui passe, l'amour, le travail mais aussi la mort, des thèmes longuement étudiés par Ozu offrant au cinéma et à son cinéma une richesse permanente. Ce Printemps précoce use donc des thèmes chers au cinéaste, quand bien même la tendance se veut être "chronique de salarymen" avant d'être "chronique sur l'amour". Il y a certes une grande importance donnée à Shoji et à la relation qu'il entretient avec ces deux femmes, mais Ozu ne délaisse pas pour autant la chronique/critique sociale sur la condition des salarymen. On y verra alors des hommes à bout de souffle, perdus et considérés comme "sans espoir" dont leur état de santé dépend tout simplement de l'état de leur entreprise dans la mesure où si elle est amenée à fermer, ses employés ne pourront pas retrouver de travail, la plupart dépassant la bonne quarantaine.

Aussi, Printemps précoce est un film humaniste, Ozu ayant un regard suffisamment objectif pour traiter ses thèmes sans paraître preneur de tel ou tel parti. Chaque personnage a ses défauts, ses qualités. Certaines séquences sont même admirables et plutôt surprenantes dans la mesure où le cinéaste se permet quelques rebonds particulièrement marquants, comme lorsque l'on apprend subitement le décès de Miura alors qu'il semblait guérit de sa maladie. Si la grâce n'est pas réellement présente, la noirceur l'emporte sur tout. Photographie sombre et intérieurs très chargés et compliqués, comme si ils représentaient la mal-être des personnages, leurs états d'âme et leur condition de travaille difficile. Quelque chose d'intéressant aussi, Printemps précoce rassemble peut-être les "dernières forces" du cinéma muet d'Ozu, tout du moins sa période des années 40 début 50 où Ozu utilisait les travellings lors des balades, ou les zooms pour appuyer l'action, le propos. Printemps précoce contient donc ces éléments là, mais utilisés avec parcimonie et surtout utilisés pour une des dernières fois : on y trouve en tout et pour tout un zoom insignifiant, un travelling qui l'est tout autant et un échange de baffes rappelant les Ozu de la fin des années 30. Printemps précoce est donc une des dernières lettres d'Ozu aux thèmes qu'il chérissait et à une mise en scène sous influence qui allait bientôt disparaître au profit d'un travail en couleur somme toute admirable.
Adultère, mode d'emploi
Comment Howard Hawks, avec un minimum de fusillades, de chevauchées et de bagarres, une petite ville de studio pour seul décor et une abondance de dialogues parvient-il à réaliser le plus beau western du septième art ? De la même manière, Ozu ne nous montre pas de courses-poursuites, de meurtres ou de lancers de tartes à la crème pour nous faire vibrer, et pourtant, on boit ses films comme du petit lait. Quelquefois, la magie du cinéma ne s'explique pas. Ou alors la meilleure explication se trouve dans les propos d'Ozu lui-même lorsqu'il donne sa vision d'un film réussi: "
Les films d'intrigues trop élaborées m'ennuient. Naturellement, un film doit avoir une structure propre, autrement ce ne serait pas un film, mais je crois que pour qu'il soit bon, il faut renoncer à l'excès de drame et à l'excès d'action." Cette opinion pourrait bien sûr être sujette à débat quand on sait, à titre d'exemple, ce qu'un John Woo nous a sorti avec des larmes, du sang et des explosions, mais elle résume parfaitement la philosophie de l'auteur des beaux
printemps,
étés et
automnes – qu'ils soient précoces, tardifs ou même crépusculaires – et la façon dont elle nourrit son œuvre.
Printemps Précoce est, comme presque tous les Ozu de cette époque, une variante sur les problèmes matrimoniaux et le « semi » mal-être des fonctionnaires japonais d'alors. Le réalisateur explore les difficultés d'un couple en pleine crise et ses efforts de réconciliation comme il le fit déjà dans
Le Goût du Riz au Thé Vert mais en abordant cette fois le thème de l'infidélité, décliné de mille et une manières au cinéma et pour lequel Ozu choisit la pudeur et l'ellipse qu'on lui connaît. Il porte en outre un regard quelque peu désabusé sur la bureaucratie, d'où culmine le monologue glaçant d'un rond-de-cuir proche de la retraite constatant qu'il aura travaillé toute sa vie à la sueur de son front pour au final obtenir moins que des miettes. Si les échanges du couple Ryo Ikebe - Chikage Awashima n'ont pas tout à fait la force de ceux du
Goût du Riz au Thé Vert avec Shin Saburi et Michiyo Kogure, le film trouve en revanche ses instants de grâce dans les scènes d'adieu ou de commémoration (le décès d'un collègue, le départ du personnage principal muté en province) qui figurent parmi les plus poignantes de la carrière d'Ozu. Formellement, on s'éloigne un peu plus des mouvements d'appareil d'autrefois (encore présents à dose homéopathique) pour se diriger vers une fixité des plans et une rigueur des cadres qui deviendront essentielles à partir de
Crépuscule à Tokyo. Interprétation et musique au sommet, comme toujours chez le cinéaste.
Ozu le plus grand? 
Un chef d'oeuvre de plus.
A voir pour la magnifique
Blues du salary man
Réalisé entre les deux chefs d'oeuvre que sont Voyage à Tokyo et Crépuscule à Tokyo, cet avant-dernier film en noir et blanc d'Ozu est admirable. Il est tout d'abord assez remarquable pour son originalité dans l'oeuvre du maître : il n'est pas ici question de mariages arrangés ou de conflits entre générations mais, pendant 2h25, d'une banale crise au sein d'un couple. Naturellement, les choses sont plus complexes : à une trame très narusienne (le couple s'ennuie, il la trompe un soir, il hésite à la quitter) se juxtapose l'admirable ampleur de vue de Ozu, dissimulée sous le vernis intime et familier des scènes de repas et de la vie de bureau. Derrière les deux protagonistes principaux, apparaissent donc petit à petit, en un motif très délicat, une analyse sociologique forte et subtile de la condition de salaryman (les mutations, les espoirs de promotion, le pouvoir d'achat, les sacrifices envers l'entreprise), des étonnants portraits de femmes libres (la maîtresse, la belle-soeur), un arrière plan émouvant sur les amitiés masculines (les banquets d'anciens combattants, le collègue mourant). Appelez la conclusion du film comme vous voudrez (fatalisme, résignation ou acceptation du sort), elle est bouleversante. Un grand Ozu, assez sous-estimé.