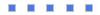Weerasethacool, tranquille...
En fait de syndrome, il s’agit de celui bien connu des gros lourdauds Paul et Pierre des « paupières sont lourdes ». Si le syndrome adhère a une bosse, le chameau, lui, en a deux. Comme le syndrome des seins d’Romy Schneider tiens. Bon…
Si les prises de risque hallucinantes du métrage emportent, elles, l’adhésion (acteurs qui s’expriment en tant qu’eux-mêmes – acteurs - hors champs, une femme fixant de son regard bovin la caméra lors d’un long travelling arrière inutile, etc), qu’on admet qu’une certaine ambiance est posée, que l’intelligence du propos est indéniable et l’expérience du souvenir vécu selon les contextes intéressante, on ne peut écarter un point de détail pour le moins gênant : c’est très chi-ant. Et d’une maladresse… Certains acteurs ne peuvent s’empêcher de zieuter la caméra. Si c’est voulu, admettons, mais si ça ne l’est pas, est-ce alors justifié par la bizarrerie de l’ensemble ? Trop facile ça, noyer un certain amateurisme par du clin d’oeil complice au spectateur. La mise en scène alterne quelques bonnes idées avec surtout pas mal de foutage de tronche, et les vraies bouffées d’air frais réussies sont souvent dues à des ressorts piochés lors de situations improvisées, de celles qui enrichissent un documentaire par exemple (le guitariste, le dernier plan dansant…). Weerasethakul possède son propre univers. C’est cool, il n’est pas pressé. Ca change. Et l'expérience est réussie en fin de compte: avez vous remarqué qu’on se souvient toujours plus des films ennuyeux que des autres ?…
Contemplation, réflexion, cinéma
Cinéaste contemplatif et naturaliste, Weerasethakul affirme une nouvelle fois sa singularité en Thaïlande et dans le monde avec Syndromes and a Century, œuvre lente et belle qui fait écho à ses précédents Blissfully Yours et Maladie Tropicale. A partir de scènes d’une apparente banalité, à partir de longs plans fixes sur des conversations pas forcément passionnantes de prime abord (dont le traditionnel rendez-vous chez le médecin commun à ses films), il parvient à créer une sorte d’hypnose et de fascination pour ses images grâce à des personnages souriants et mystérieux qui parlent doucement et gentiment, et grâce aussi à un travail sur le son vraiment stupéfiant – parfois proche de celui de David Lynch.
 Mais au-delà de la contemplation, Weerasethakul propose une comparaison des modes de vie ville/campagne particulièrement bien vue et toute en finesse. La première partie, située à la campagne, montre en effet des humains heureux, sereins et spontanés, en harmonie avec la nature qui les entourent, ses jardins, ses orchidées ou ses points d’eau, un lieu ou les rencontres sont possibles. Puis, comme à son habitude, il embraye à la moitié du film vers une seconde partie à la fois bien distincte et très proche de la première : ce sont les mêmes personnages, les mêmes situations, mais cette fois situés au sein de la ville tentaculaire de Bangkok. Et l’on peut alors observer des différences de comportement à première vue insignifiants, mais très symptomatiques sur les 2 modes de vie exposés ici. Lors de l’entretien d’embauche à la campagne, le jeune médecin ose une proposition humoristique et tendancieuse sur le sigle « DDT », mais il ne l’ose pas à la ville. Les échanges entre le vieux moine et son médecin semblent moins cordiaux à la ville qu’à la campagne. La femme dont la jambe la fait souffrir se soigne de manière traditionnelle avec des bains de boue dans la rivière dans le premier cas, puis déambule dans les couloirs d’un hôpital moderne et froid sans que l’on ait l’impression que les soins soient plus efficaces. Quant aux relations amoureuses, elles semblent plus directes et brutales à la ville, mais se font de manière cachée des autres, avec un désir qu’il faut contenir dans son pantalon alors qu’il s’exprimait à l’air libre à la toute fin de Blissfully Yours, au bord de la rivière. De même, la caméra est placée en opposition frontale d’une scène à l’autre : si le personnage central est en position de don à la campagne (le candidat qui propose ses services au dispensaire, la jeune docteur qui prodigue ses conseils), il est au contraire en position de réception à la ville.
Mais au-delà de la contemplation, Weerasethakul propose une comparaison des modes de vie ville/campagne particulièrement bien vue et toute en finesse. La première partie, située à la campagne, montre en effet des humains heureux, sereins et spontanés, en harmonie avec la nature qui les entourent, ses jardins, ses orchidées ou ses points d’eau, un lieu ou les rencontres sont possibles. Puis, comme à son habitude, il embraye à la moitié du film vers une seconde partie à la fois bien distincte et très proche de la première : ce sont les mêmes personnages, les mêmes situations, mais cette fois situés au sein de la ville tentaculaire de Bangkok. Et l’on peut alors observer des différences de comportement à première vue insignifiants, mais très symptomatiques sur les 2 modes de vie exposés ici. Lors de l’entretien d’embauche à la campagne, le jeune médecin ose une proposition humoristique et tendancieuse sur le sigle « DDT », mais il ne l’ose pas à la ville. Les échanges entre le vieux moine et son médecin semblent moins cordiaux à la ville qu’à la campagne. La femme dont la jambe la fait souffrir se soigne de manière traditionnelle avec des bains de boue dans la rivière dans le premier cas, puis déambule dans les couloirs d’un hôpital moderne et froid sans que l’on ait l’impression que les soins soient plus efficaces. Quant aux relations amoureuses, elles semblent plus directes et brutales à la ville, mais se font de manière cachée des autres, avec un désir qu’il faut contenir dans son pantalon alors qu’il s’exprimait à l’air libre à la toute fin de Blissfully Yours, au bord de la rivière. De même, la caméra est placée en opposition frontale d’une scène à l’autre : si le personnage central est en position de don à la campagne (le candidat qui propose ses services au dispensaire, la jeune docteur qui prodigue ses conseils), il est au contraire en position de réception à la ville.
Ce symbolisme atteint son apogée dans la scène finale où un énorme tuyau situé au beau milieu d’une des salles de l’hôpital vient avaler un nuage de poussières, comme si les âmes vivant dans des lieux clos loin de la nature étaient petit à petit absorbées et vidées de leur substance… Véritable oeuvre d’art dont ma lecture personnelle en vaut d'autres, Syndromes and a Century intéressera tous ceux qui cherchent un Cinéma qui sort radicalement des sentiers battus, et le Lotus d‘Or de Deauville devrait aider à les y pousser.
Un film parfois exceptionnel 
Cinquième film en date de WEERASETHAKUL Apichatpong, Syndromes and a century demeure une impressionnante chronique sur le monde de la médecine et les relations internes de l'établissement. Mieux encore, le cinéaste s'attarde à rentrer plus pleinement dans les relations amoureuses des protagonistes, à mettre en parallèle leur vécu et histoires, en alternant les milieux sociaux. Une première partie avec en ligne de mire l'histoire d'une femme médecin dans un milieu particulièrement pauvre, et une seconde suivant de la même manière un homme cette fois-ci dans un cadre bien plus développé. Pourtant seul le cadre change, puisqu'on y trouve les mêmes patients ou les mêmes problèmes, l'occasion de sourire sur les hallucinations d'un moine attaqué par des poulets, ou les pérégrinations d'un dentiste chanteur de variété Thaï. Mais l'oeuvre de WEERASETHAKUL Apichatpong étonne par sa sidérante manière d'interpréter le courant de la vie, symbolisé par des plans contemplatifs filmant du "vide" sous une bande-son surréaliste et planante. On y trouve même du Ozu dans cette manière de clore les choses en filmant des pièces, vides et dont les lumières s'éteignent comme pour annoncer la fin d'une histoire, menée par des interprètes criants de naturel et dans le fond, malgré leurs histoires somme toute banales, attachants.

Syndromes and a century puise sa force dans l'étrangeté, alliée à ce récital du quotidien de gens normaux, sublimé par l'innovante mise en scène. On ne parle pas de mise en scène matérielle, plastique à proprement parlée, mais de la direction des choses, d'un ensemble cohérent, les plans étant majoritairement fixes, longs d'une dizaine de minutes, mais ponctués par de véritables moments de grâce qui ne s'expliquent pas, mais qui se vivent. Ces statues de Bouddah filmées en travellings, ces errances, cette parabole des milieux sociaux, cette répétitivité des choses (deux histoires presque identiques, mais vues d'un oeil différent), toute cette alchimie contribue à rendre le dernier récompensé du festival difficilement oubliable. Une vraie science de l'étrangeté.
Le reflet des souvenirs
Impossible de résumer (une nouvelle fois) le dernier opus du plus talentueux des cinéastes indépendants contemporains thaïlandais – voire mondiaux. Weerasethakul réussit chaque nouvelle fois à surprendre et à perpétuer un univers bien à lui. Ce ne sont pas des films à proprement parler, mais des véritables œuvres d'Art, des expériences filmiques s'adressant directement au ressenti et à l'ensemble de nos sens.
Œuvre d'autant plus personnelle, qu'elle est basée sur le souvenir de ses parents – ou plutôt des souvenirs de ce que ses parents aient bien voulu lui raconter du comment de leur première rencontre. Apichatpong va donc explorer plusieurs notions: celle du souvenir de ce dont il pense se souvenir avoir entendu / retenu et en en donnant sa propre représentation par le film. Au-delà du souvenir – forcément déformé par sa propre perception et de ce qu'il s'en souvient encore – il s'agit également de souvenirs "faussés" de ses parents. Ils lui ont raconté leur version des choses, versions également altérées par "l'usure" du temps (ce qu'ils s'en rappellent), de la transmission d'idées (comment ils réussissent à transmettre le souvenir, donc à traduire leur pensée par la parole), de leur perception des choses (comment chacun d'entre eux aura vécu une situation, pas forcément ressenti pareil par l'autre) et de ce qu'ils aient bien voulu lui raconter (sans doute ne lui ont pas tout raconté, ni dévoilé l'ensemble de leurs ressentiments les plus profonds, donc de l'ordre de l'intime).
L'altération de nos souvenirs ont été exploitée à des nombreuses reprises dans des films mondiaux récents, à commencer par le très bon "Eternal Sunshine of the spotless mind" ou encore "Paprika". Aptichatpong pousse pourtant le procédé encore plus loin, en explorant toutes les différentes formes d'altération énumérées ci-dessus. Il n'hésite donc pas à déplacer un premier cadre de la campagne à la ville, de mélanger des notions temporelles du passé (l'histoire effectivement vécue) avec le présent (plus proche de nous), à démultiplier les points de vue (une même scène est reprise par les protagonistes à deux moments différents avec une différence de point de vue de la caméra et des dialogues très légèrement modifiés), etc.
Tels des souvenirs, des bribes de pensée sont abordées, pour être abandonnées par la suite (le dentiste chanteur; le moine qui a voulu devenir DJ).
Et toutes ces formes éthérées finissent aspirées par un énorme trou noir pour être conservées en un for intérieur mystérieux et inconnu.
Une vraie œuvre d'Art, dont chaque lecture dévoile une nouvelle facette. Et la capture d'instantanés terriblement ancrés dans le quotidien et la réalité des choses; et de témoigner de la proximité de l'artiste avec son environnement immédiat. Jamais encore la Thaïlande n'avait été aussi bien capté!!!
La joie, en 1907 
C'est la construction narrative d'une Vierge mise à nue par ses prétendants malaxant le thème de l'urbanisation déshumanisante et asphixiante du récent Norway of Life. C'est riche, élégant, ennivrant, drôle. Et ça ne s'oublie pas de si tôt.